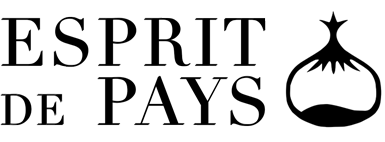Les bateliers n’étaient pas en général des gens faciles. Ils menaient une vie dangereuse nécessitant du courage, mais aussi beaucoup d’adresse. Peut-être est-ce pour cela qu’ils avaient le sentiment d’une certaine supériorité sur les terriens ? Ils affirmaient d’ailleurs avec plaisir : « Si vilain sur terre, seigneur sur l’eau je suis ». Lorsqu’ils ne naviguaient pas, ils travaillaient comme pêcheurs, bûcherons ou participaient à la construction de leurs embarcations, refusant les travaux agricoles, même en été, lorsque l’étiage interdisait toute navigation. (1)
Sous ses airs paisibles, la Dordogne est en fait une rivière sauvage qui peut se montrer traître, comme en témoignent ces paroles que les enfants chantaient au passage des gabariers : « Gare, gare, gabarier. Tu as la mort sous les pieds. Mais elle te suit, par derrière. ». Oui, la Dordogne n’a cessé de prélever sa rançon d’hommes tout au long de l’histoire de la batellerie. Fort logiquement, les bateliers étaient des hommes courageux, pleins d’énergie, d’audace et de sang-froid. Véritables professionnels de la batellerie, ils avaient une connaissance parfaite de la rivière, et une grande maîtrise face aux nombreux dangers du parcours.
Les bateliers sont des hommes vigoureux, hardis mais prudents. Il faut endurer le froid, la chaleur, les immersions prolongées. Ils sont respectés et il vaut mieux éviter de les provoquer, car ils n’hésitent pas à se servir de leurs poings. Le nommé Baloup, beau-frère de Jean Brouillet, est un soir mis en prison après une rixe à Lalinde. Longtemps, une inscription demeura gravée sur la porte de la prison : « Adieu prison, adieu verrous, vous ne reverrez plus Baloup ! »
Une vie de labeur pour les gabariers
Dans le Périgord, le Quercy et le Rouergue, le gabarier et le merrandier ne font qu’un. Les travaux agricoles finis, les hommes de la vallée, des crêtes, des plateaux, deviennent gabariers meirandiers ou meyrandier. Le gabarier est patron et manœuvre, bûcheron, faiseur ou marchand de merrain, vendeur de bois de chauffage, ouvrier fendeur de carassonne, débardeur, chargeur, toutes professions qui lui valent qualification de meirandier. D’autres sont charpentiers et gabariers.
Il faut qu’ils aient le goût de l’aventure, quittant leurs familles pour plusieurs semaines. Ces gaillards doivent affronter les malpas, semés de récifs sur lesquels s’écrasent parfois les bateaux dont l’équipage n’ont pas su manœuvrer habilement les pâllas, ces longues rames ferrées, ou qui n’ont pas assez rapidement obéi aux ordres du capbastel ou capitaine du bateau.
Les équipages chantaient pour se donner du cœur au passage des rapides, tout en assurant la manœuvre difficile entre les roches. À la moindre hésitation, à la moindre inattention, le voyage s’arrêtait brusquement dans un fracas de bois déchiré. L’accident pouvait être mortel ; malheureusement, il en arrivait et, du caractère périlleux de cette navigation, le gabarier du haut-pays tirait un prestige appelant pour lui, chez les bateliers d’aval, considération et respect.
Christian Signol a fait trois ans de recherche pour comprendre comment ces gabarriers vivaient, pauvres sans être miséreux, soumis aux marchands qui les employaient. « La Dordogne était plus dangereuse qu’aujourd’hui, avec des tourbillons et des remous. Le travail des gabarriers était périlleux. Échouages et collisions fréquents. Si l’un d’eux tombait, on ne parvenait pas toujours à le récupérer. Les marchands payaient les bateliers au voyage. En cas de retard ou d’accident, les conflits éclataient. » La dépendance des hommes d’équipage à l’égard du maître est totale.
De nombreux accidents, une mortalité élevée chez les gabariers
Le métier est dangereux et les accidents sont nombreux. Les raisons des naufrages suivent un cycle saisonnier. Largement en tête, viennent les accidents météorologiques. Sur les 160 naufrages recensés en Moyenne et Basse-Dordogne sur la période 1727 à 1790, 115 – soit 71,93% – ont lieu d’octobre à mars. Les mois les plus périlleux de cette période sont février, mars et octobre. Presque toujours, leur soudaineté et leur violence surprennent les équipages, empêchent les manœuvres et désemparent des embarcations fluviales peu faites pour résister. Il en est de même d’évènements prévisibles comme le mascaret ou le renversement des vents avec la marée, lorsque leur ampleur dépasse les prévisions des bateliers et que le flot progresse trop vite entre les rives du fleuve, avant d’être freiné par la rencontre des premiers méandres. (2)
Viennent ensuite les erreurs de navigation, également responsables de bon nombre d’accidents parmi lesquels des collisions : sept collisions de bateaux ont été recensées de 1727 à 1770 et vingt-deux de 1770 à 1790. Ces deux chiffres sont très vraisemblablement inférieurs à la réalité, mais ils confirment l’encombrement des fleuves périgourdins dans les vingt dernières années de l’Ancien Régime. Ce qui fait que l’intensité du trafic et la permanence des obstacles qui les jalonnent, ont fait d’eux des voies dangereuses. (2)
Parmi les naufrages relatés dans les annales, il y a celui qui eut lieu à Pâques 1648, dans le secteur du Coux ou de Limeuil, et qui coûta la vie à 70 pèlerins environ, revenant par bateau de la dévotion de Cadouin au Saint-Suaire. Entre 1785 et 1800, 70 mariniers périrent dans les passages dangereux disséminés entre Argentat et Souillac. Un rapport de l’ingénieur des Ponts et Chaussées de Bergerac relate un autre accident qui s’est produit le 6 juillet 1843 dans les courants des Pesqueyroux à Lalinde :
« Le sieur Martra, marin, chargé de faire à la tâche le transport des moellons extraits à Cénac pour le mur à pierres sèches de Saint-Capraise, descendait avec l’aide du sieur Jean Loubradou, dit Nantais, environ quatre mètre cubes de moellons dans son bateau dit Gabagrot second ; lorsqu’arrivé au passage des Pesqueyroux, le bateau toucha et se défonça tellement qu’il disparut à l’instant. Les sieurs Martra et Loubradou furent, par suite, obligés de s’élancer à l’eau dans les brisants des Pesqueyroux. Le premier réussit avec peine à gagner le bord ; le second, quoique bon nageur, n’a pu gagner terre et a trouvé la mort dans les forts courants. Le sieur Loubradou, ancien marin d’État, était âgé de 55 ans. »
Dans La Haute-Dordogne et ses gabariers, Bombal décrit l’accident survenu au pont de Spontour, un jour de Noël 1885, à un bateau chargé de merrain ayant pour patron un gabarier d’Argentat, Pierre Dufour, et pour manœuvres deux hommes de Saint-Projet :
« Le courant se précipite toujours avec violence contre les piles du pont ; le patron gabarier, qui n’aurait eu qu’à tenir droit pour franchir l’arche où l’on passe, manœuvre de telle sorte qu’il mit le bateau en travers contre une des piles, les eaux tourbillonnantes et fortes envahirent le bateau, dispersèrent la charge… Des trois hommes montés sur la gabare, un seul, Dufour, put se sauver à la nage, les cadavres des deux manœuvres furent retrouvés, l’un à 100 mètres en aval, et l’autre à Mols, à l’entrée du département du Lot, où Jean-Baptiste Blaudy (le narrateur), patron gabarier d’Argentat descendant un bateau, l’aperçut, accroché à des branches. » (4)
Pour se prémunir des accidents, les bateliers s’entourent de garanties techniques.
- La première précaution, primordiale pour le début de la descente, est le choix du moment du départ. Il s’agit de fixer le plus précisément possible l’arrivée des « eaux marchandes » sans se laisser abuser par les orages locaux qui ne font que gonfler le niveau de la rivière, mais ne suffisent pas « à porter » les embarcations sur les hauts-fonds. La décision prise, tous les départs se précipitent afin de profiter pleinement de la courte saison des eaux marchandes et de rattraper le temps perdu de l’été.
- La deuxième précaution consiste à arrimer avec soin les embarcations. Si les cargaisons de bois sont faciles à arrimer, celles de charbons sont responsables de bien des accidents. Les cargaisons en vrac posent encore davantage de problèmes au transporteur qui doit les garantir contre le mauvais temps et les empêcher de riper le fonds du bateau, au risque de le déséquilibrer dangereusement.
- La troisième précaution consiste à voyager en convois. La proximité de bateaux facilite l’allègement et le transbordement ; en cas d’accident, la présence de bateaux connus est une garantie d’entraide à moins que tout le convoi ne soit, à son tour, désemparé par la même tempête. (2)
Une activité saisonnière pour les gabariers
Très souvent, les bateliers étaient propriétaires de leur cargaison, fruit de leur travail de l’hiver, qu’ils menaient ainsi vendre par eau. Durant dix mois de l’année, en dehors de la pêche – qui, en plus d’une grande part de leur alimentation, leur fournissait quelques ressources par la vente du poisson – ils étaient bûcherons. Ils abattaient les arbres, débitaient le merrain, fendaient la carassonne, sciaient planches et madriers. Ces régions boisées de l’Auvergne fournissaient d’ailleurs la plupart des scieurs de long itinérants que l’on rencontrait alors sur tous les chantiers de France. Leur grande scie, qui les suivait partout, était surnommée la « bannière d’Auvergne » par les charpentiers du compagnonnage. Habiles à manier hache et herminette, ils participaient aussi à la construction de leurs bateaux, ces longues gabares aux extrémités relevées, qui, le moment venu, partaient pour leur unique voyage sans retour.
Le fait qu’ils ne pratiquaient qu’une navigation saisonnière, et encore sur une très courte période, fit longtemps hésiter sur le classement professionnel des gabariers de la haute Dordogne. Pour cette raison, l’inscription maritime, qui depuis Colbert englobait tous les métiers de l’eau, ne leur fut appliquée que tardivement, en 1779, et seulement à partir d’Argentat. On trouve ainsi quarante gabariers de ce port, servant à bord des vaisseaux de la République en 1794. En réalité, ils étaient davantage bûcherons et marchands de bois que bateliers, la gabare étant seulement le moyen de transport qu’ils employaient pour livrer leur production. On les appelait ainsi indifféremment « gabariers » ou « meyrandiers », c’est-à-dire faiseurs ou marchands de merrain.
Gabarier, une activité transmise de père en fils
On ne pouvait pas devenir gabarier avant 15 ans. Il y avait des risques dans ce métier : la gabare pouvait couler, les hommes tomber à l’eau et se noyer, d’autant plus que beaucoup ne savaient pas nager. Ils étaient payés par le propriétaire du bateau.
Le temps inexorable passant sur les générations, le métier de gabarier était inculqué aux enfants mâles dès leur plus jeune âge, et de père en fils on était gabarier, surtout celui du patron. En effet, un patron qui avait des enfants, à mesure que ceux-ci atteignaient leur onzième année, commençaient à suivre le père, et il n’était pas rare de voir aux chevilles de la godille ou gouver, derrière le patron, un gamin de onze ou douze ans, servir de second et d’aide à son père. Ceux-ci étaient pour l’avenir de futurs patrons, attirés par l’ambiance de l’eau, des bateaux, des conversations que tout enfant recherche comme jeux dès son plus jeune âge. Plus tard, lorsque ces hommes ayant été contraints par l’âge à abandonner le métier, l’on voyait des vieillards, usés, courbés, venir au bord du quai, au moment du départ d’un fils, pour larguer lou chabristi, les amarres. Ils ne manquaient pas de donner des appréciations sur le bateau en partance, sur son chargement, sur son équipage, le temps probable de la journée, et d’un air triste et mélancolique, regardaient s’éloigner ce fils qui lui rappelait le temps de son activité.
Les vieillards disparus, les années se succédant ainsi, la besogne d’un père de famille était transmise de père en fils, et se continuait ainsi de génération en génération.
Les enfants naissant près de la Dordogne, souvent conçus au retour d’un de ces voyages, grandissaient et vivaient en élevant à leur tour une famille qui se perpétuait. Les vieux faisant place aux jeunes, aucun d’eux n’a réalisé de fortune, mais, souvent, ils élevaient une nombreuse progéniture. (2)
Pour être batelier, il fallait être en pleine possession de ses moyens. Dès que les forces déclinaient, il fallait passer le relais aux plus jeunes.
« De son air triste et mélancolique, le père gabarier regarde partir son fils, ce fils qu’il a conçu au retour d’un de ces nombreux voyages, lui rappelle par ses gestes, l’époque déjà lointaine de son activité. Les vieillards disparus, les années se succédant, la besogne d’un père de famille est ainsi transmise jusqu’à aujourd’hui. Aucun d’eux n’a atteint la fortune. » (2)
Un rite d’initiation pour devenir gabarier
Dans son livre Gabarier sur la Dordogne, Jean-Baptiste Blaudy décrit ainsi le rite d’initiation du jeune gabarier :
À ce moment, nous découvrons un beau château enfoui dans un bocage de peupliers très épais. C’est le château de Piles. Maintenant, nous tournons notre regard vers la rive droite, nous remarquons encore un autre château dont on ne voit qu’une partie de sa masse, cachée par le sommet du coteau. C’est celui de Tierçant.
Ici, je dois quelques détails sur notre corporation des gabariers. Lorsqu’un jeune effectue son premier voyage, il est dans la tradition de le recevoir « officiellement » dans la corporation. La cérémonie s’effectue par surprise et ne dure que quelques secondes. Quoique souvent prévenu par quelques bavards, l’aspirant gabarier ne sait pas exactement où cette petite facétie doit avoir lieu, puisqu’il est impossible de découvrir les deux châteaux parrain et marraine que lorsqu’on est en face. Mais le patron gabarier trouve toujours une manœuvre à faire exécuter même qu’elle ne soit d’aucune utilité, de façon à absorber l’attention du novice.
À ce moment, le pilote ou patron gabarier prend dans sa main une poignée d’étoupe qu’il a trempée dans l’eau, et d’un geste prompt saisit la coiffure du novice d’une main puis, de l’autre, il presse l’étoupe imbibée d’eau qui fait l’effet d’une éponge, et douche copieusement la tête du novice.
Ici, dans ces contrées, nous n’avons pas besoin de conserver la distance entre chaque bateau à part pour le passage des ponts ; de ce fait, on voit souvent des bateaux assez près les uns des autres, donc, les équipes des autres bateaux attentifs au moment précis se découvrent, et de tous les bateaux qui suivent ou qui précèdent. Le patron qui a donné cette petite comédie crie aux autres camarades : « una aoûssa a mïnza » (une oie à manger). Le soir venu, et au lieu du couchage, il y a quelques litres supplémentaires aux frais du nouveau promu. Voici les paroles prononcées par l’officiant en découvrant le novice et en l’aspergeant en même temps :
C’est entre Pile et Tierçant
Que l’on baptise l’enfant
Faute de vin avec de l’eau
Pour que le bon Dieu en fasse un bon matelot.
Cette douche inattendue n’a rien d’agréable surtout par temps froid et la brise du large. C’est une tradition, et celui qui voudrait s’y dérober se verrait aspergé avec l’espoujadour. (3)
Une solidarité indispensable parmi les gabariers
Argentat était le port de rassemblement des gabares descendues de l’amont, du haut pays, et qui y arrivaient en général à demi chargées par suite de difficultés du parcours. On complétait là leur cargaison et, après un arrêt de trois ou quatre jours et un pèlerinage à Sainte Madeleine qui se terminait par une longue procession jusqu’au quai, elles repartaient en flottes, plus ou moins nombreuses. C’étaient alors sept, huit, une douzaine, parfois plus, de bateaux se suivant en file, qui descendaient ainsi vers l’aval, vers Souillac, Limeuil, au confluent de la Vézère, Lalinde, Bergerac, et parfois jusqu’à Libourne. C’était une navigation de solidarité. (5)
Les gabariers se groupaient, les uns avec le sac d’écus provenant de la vente, et qui à lui seul représentait un poids respectable pour un marcheur, les autres avec le paquet de cordages. Ils reprenaient le chemin du retour à pied, le chemin d’Argentat, accompagnés dans leur long parcours pédestre par de nombreux autres collègues qui, comme eux, regagnaient leur domicile.
La durée du retour était en moyenne de quatre jours. Chaque homme, manœuvres ou pilotes, remontait à ses frais ; ceux-ci étaient réglés et payés avant le retour, et invariablement, ils avaient leurs haltes, leurs auberges. Les consommations étaient d’un prix à faire rêver de regret les hommes modernes. Le prix du litre de vin, six liards (deux ou trois sous au plus), le prix du repas tel qu’au Coq Hardi, à Périgueux, était de dix sous, avec comme menu : soupe à volonté, un plat de viande, légumes, fromage, vin à volonté : quelques-uns abusaient de la boisson à discrétion, aussi étaient-ils souvent en arrière-garde de chaque colonne. Les plus sobres, généralement les meilleurs marcheurs, arrivaient souvent à Argentat une bonne journée d’avance avant les traînards. (3) —Gabarier sur la Dordogne, Jean-Baptiste Blaudy, Édition établie par Guitou Brugeaud, La Table Ronde, Paris
Les gabariers regagnaient leur point de départ à pied, soit quinze jours à trois semaines de marche, pour refaire les 350 kilomètres qui les séparaient de leur domicile, en empruntant les chemins de halage, puis à travers les forêts des gorges de la Dordogne. D’autres bateaux les y attendaient tout chargés. Ils n’effectuaient donc que 2 ou 3 descentes par an. Avec l’avènement du chemin de fer, certains équipages arrivaient à descendre jusqu’à dix bateaux dans la saison.
Croyances et superstitions chez les gabariers
La veille de chaque départ, un curé bénissait les hommes et les bateaux, car le voyage était à certains endroits particulièrement dangereux à cause des nombreux rapides. Beaucoup de gabariers n’étaient pas sûrs de revoir leur village et leur famille, car les accidents étaient fréquents malgré leur courage et leur adresse.
Lorsque s’annonçait la crue qui porterait les courpets jusqu’à Bergerac ou plus bas, une bénédiction des équipages devant la croix des Gabariers du port d’Argentat marquait la gravité du moment, rappelant le danger du voyage et les espoirs de gains qu’il faisait naître. Dans les moments les plus incertains de la descente, les gabariers invoquaient sainte Barbe, patronne de leur confrérie. — Vallée de la Dordogne, Gallimard. (6)
En haute Dordogne, les gabariers faisaient halte pendant trois jours à Argentat, à la descente pour un pèlerinage à Sainte Madeleine qui se terminait par une procession vers les quais. Un autre arrêt que leurs croyances obligeaient, s’effectuait à la chapelle des pénitents, « Capèlla de Nostra-Dama-del-Port-bas », située à la sortie de Beaulieu, pour remercier la Bonne Mère de les avoir sauvegardés lors du passage du malpas. Ils allumaient alors des buissons de cierges. Les gabariers eux-mêmes priaient pour franchir les malpas et les ajustants, les tombants et les maigres.
Le dimanche des Pâques ou le jour de l’ozanne, en référence du cri d’exclamation du christ lors de son entrée à Jérusalem. Certains les appelaient « Pâques à buis » à cause de la bénédiction des rameaux verts. Les gabariers interrogeaient le ciel, car le vent dominant de l’année sera celui qui soufflera pendant la lecture de l’évangile ou pendant la bénédiction de la croix Hosannière. (7)
En plus des fêtes religieuses de Pâques et de Pentecôte, celles de Noël et du quinze août (Assomption, fête de la Vierge), il y avait une cérémonie très essentielle que tous les marins n’auraient pour rien au monde négligée : le baptême de leurs bateaux. (7)
Termes patois utilisés pour manœuvrer la gabare
- Cachar : presser, appuyer, c’est pousser la barre du gouvernail à gauche (en regardant l’aval), la plume étant dans la position vertical par rapport à sa largeur, la barbe en haut. La conséquence de ce mouvement est que l’avant du bateau se dirige vers la droite. Tinons charra : tenons serré.
- Sarrar : ce mouvement opposé à « cachar » produit l’effet contraire.
- Couajar : godiller. C’est produire une succession continue de deux mouvements faisant faire au gouvernail un sixième environ de révolution sur son axe, la barbe de la plume en arrière. Pendant cette manœuvre, pour aller de droite à gauche et revenir de gauche à droite, la plume du gouvernail est obligée de passer et repasser par tous les plans intermédiaires entre le vertical et l’horizontal.
- Tirar : tirer c’est ramer. Les rameurs, face à l’arrière, font prendre son point d’appui à la rame vers l’avant et la tirent à eux.
- Apelar : appeler c’est faire progresser le bateau, soit en appuyant sur le fond de l’aste, soit en appelant l’eau d’avant en arrière avec la palota (petit aviron) qui remplace le gouver dans les petits bateaux de pêche.
- Tener drech : tenir droit c’est maintenir le bateau dans une direction déterminée.
- Cap-tourn : le bateau tourne horizontalement sur lui-même, présentant le flanc aux lames… Le bateau peut chavirer. (Bombay, chap. III).
Notes :
- (1) Le Fermail de la Batelière, Pascale Pillon, François Parouty, Editions Publibook, 2013.
- (2) Les gens de la rivière de Dordogne, Anne-Marie Cocula-Vaillières, Thèse présentée devant l’Université de Bordeaux III, le 5 février 1977.
- (3) Gabarier sur la Dordogne, Jean-Baptiste Blaudy, Édition établie par Guitou Brugeaud, La Table Ronde, Paris.
- (4) La Haute-Dordogne et ses gabariers, Eusèbe Bombal, Imprimerie de Crauffon, 1903.
- (5) Les gabarriers de corrèze et le vin de Bordeaux.
- (6) Vallée de la Dordogne, Encyclopédie du Voyage Gallimard.
- (6) Croyances et superstitions chez les gabariers, Jean-Paul Videau, Conservatoire de l’Estuaire de la Gironde.