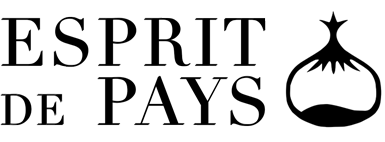Puiser dans la mémoire collective pour en faire surgir des traditions ! « Tuer le cochon » : un cérémonial festif oublié de nos campagnes…
En cette fin du mois de juillet 1960, dans une ferme du lieu-dit Le Rozier (canton de Lalinde) :
– Tu sais, dit Georges à Marie, je crois bien que la grosse est en folie, va falloir l’emmener au mâle !– Faudra te faire aider du voisin, parce que moi, je suis pas assez solide !
Le lendemain, Georges harnache le cheval, l’attelle à la vieille charrette en bois et dépose sur le plateau une grande caisse à claire-voie. Il fait ensuite reculer l’attelage jusqu’au talus.
– Arrié ! Pompon ! Arrié ! Ho !
Le grand numéro peut commencer. Munie d’une petite auge remplie de baccade, Marie s’approche de la truie et l’attire vers le talus et la charrette. Jusque-là tout va bien. Mais arrivée près de la cage, la bête hésite. Georges et le voisin venu en renfort sont alors obligés d’intervenir. On tire, on pousse. Des mots doux aux gros mots, tout y passe… jusqu’à ce que la grosse de 180 kg soit enfin dans sa caisse.
Pompon se dirige lentement vers Sauvebœuf. En ce temps-là, le camp de Mauzac accueillait un grand nombre de prisonniers. Pour les nourrir, l’administration pénitentiaire disposait d’un potager mais aussi d’un élevage de cochons. Elle mettait également à disposition des paysans qui le souhaitaient un magnifique verrat reproducteur. La belle restait en pension le temps qu’il fallait, puis regagnait sa cage et…
– Hue Pompon ! Hue !
Retour à la case départ. Après trois mois, trois semaines et trois jours, la truie mettait bas.
Rencontre avec « Lou Moussur1 »…
À ce moment du récit, parole est donnée à un porcelet qui va narrer lui-même sa courte vie :
« Né le cinquième d’une portée de douze, j’étais le plus beau et le plus déluré. Rond, rose à souhait, un arrière-train large et dodu, la queue la mieux tire-bouchonnée, bref, le préféré de maman !
Quel bonheur ! Quelle joie de vivre ! Une enfance de rêve. Imaginez douze porcelets jouant, trottinant ou tétant en même temps. Ah ! la tétée, quel plaisir ! Maman couchée sur le flanc, offrant ses quatorze mamelles à nos ventres affamés… On mâchouille goulûment, sans perdre une goutte, et puis dodo. À ce régime-là, nous prenons rapidement des kilos. Au bout de quatre semaines vient la période du sevrage avec, au menu, du lait en poudre mélangé à des céréales et du tourteau de soja. Trois mois après ma naissance, je pèse déjà 30 kg ! Un beau matin, avec cinq de mes frères, nous partons en promenade.
Pompon et sa charrette nous déposent à Lalinde, place des Petits Cochons, car tous les quatrièmes vendredis du mois, le marché aux cochons se tient face à la forge. Sous les platanes, nous voyons défiler des paysans qui nous observent, nous comparent et discutent à n’en plus finir. Me voici enfin choisi par un couple plutôt sympathique qui m’entraîne pour une nouvelle promenade, mais cette fois-ci dans le coffre d’une Juva Quatre.
Au lieu-dit Lalande, près de Monclard, la voiture s’arrête enfin. On m’installe dans une cabane en pierre, près de la ferme. Maurice et Yvette sont très gentils avec moi et me nourrissent très bien. Tous les jours j’ai droit à une baccade différente. Dans les eaux grasses ou le petit lait, ils vont rajouter des feuilles de choux, des betteraves, des pommes de terre, des raves ou des topinambours. Un peu plus tard ils rajouteront du blé, de l’orge, à l’automne des glands et des châtaignes, et l’hiver venu des farines et du maïs. Cette baccade est cuite dans la chaudière en fonte près de l’étable. En voyant sortir la fumée, je salive de plaisir ! Au bout d’un an d’engraissement et de repos forcé, je commence à prendre de l’embonpoint… mais ça n’a pas l’air d’inquiéter mes hôtes, bien au contraire !
Un beau jour de février, je reçois la visite d’un bonhomme au regard bizarre. Il estime mon poids à 160 kg. Mais qu’est-ce que ça peut bien lui faire !
Peu après sa visite, un beau matin, rien dans la gamelle ! Le lendemain, rien non plus. Pourtant, je vois fumer la chaudière, donc tout va bien. Au petit matin, l’homme pénètre dans l’étable accompagné de Maurice et m’attache fermement le groin à l’aide d’une corde. Çà ne va pas être facile pour manger ! Avec une corde plus solide, ils m’attachent ensuite les pattes arrière et nous voilà partis en direction du grand chêne au fond de la cour. Nous passons près de la chaudière. De la fumée s’échappe, mais point d’odeur de baccade.
Arrivés près du chêne, la corde entravant mes pattes arrière est accrochée à un palan. Et me voilà soudain soulevé dans les airs. Là, plus de doute possible ! Je comprends qu’ils me veulent du mal : je hurle, je mugis, je gueule, mais rien n’y fait… Deux hommes me tiennent fermement les pattes avant et je sens une douleur étrange dans la gorge. Des litres de sang jaillissent de ma blessure. La vie me quitte. Je râle, je tremble, un dernier souffle et puis plus rien. Mais pourquoi m’ont-ils fait çà ? »
Autrefois on élevait le porc pour la consommation du fermier et de sa famille
Écoute bien goret, je vais te dire pourquoi ils t’ont fait ça et, si ça peut te consoler, dis-toi bien que dans le cochon, tout est bon !
Le sang coule dans une bassine émaillée dans laquelle on a versé un bol de vin rouge. Le liquide vermeil est brassé énergiquement pour éviter la coagulation. Les caillots sont rejetés, puis le sang est filtré dans une toupine en grès et conservé au chaud dans la souillarde. Le cochon est transporté sous le préau et repose sur un brancard posé sur deux tréteaux. Là, on va lui plonger les pattes dans de l’eau très chaude, enlever les ongles et racler la peau à l’aide d’un couteau. Puis, muni d’un arrosoir, le tueur va répandre de l’eau chaude sur tout le corps de l’animal et racler, racler des pieds à la tête jusqu’à obtenir une peau propre et lisse. Les derniers poils seront brûlés à la lampe à gaz.
Une petite fente est pratiquée dans les pattes arrière pour dégager les tendons. Puis les pattes sont maintenues écartées sur le cambal. Et revoilà notre goret suspendu à la poutre du préau, la tête en bas. La tête tranchée tombe dans une bassine. Tous les morceaux de viande qui la composent serviront pour le boudin. Un couteau bien affûté, manié d’une main sûre va fendre le ventre de l’animal de haut en bas, laissant apparaître les viscères. En cuisine on s’active ! Yvette va plonger les morceaux de viande de la tête et les abats dans de l’eau chaude accompagnée de sel et d’un oignon clouté de girofles.
Quand la viande est cuite, elle est introduite dans le hachoir qui va la transformer en bouillie. On va y rajouter le sang, de l’ail finement haché, du sel, du poivre et mélanger le tout.
– Passe mé l’ouillette ! (entonnoir à large ouverture et long tuyau sur lequel est enfilé l’intestin) Le mélange visqueux, couleur vermeil, est enfourné dans l’entonnoir et, emmailloté dans l’intestin, finit en un long boyau lové dans un plat rond. Le boudin est à nouveau plongé dans le peyrol pendant une quinzaine de minutes, puis posé à refroidir sur un linge propre. Dans le jus de cuisson on rajoutera des poireaux, des carottes, du chou, du thym et du laurier. Cette soupe ainsi obtenue portera désormais le nom de jimboura.
Le soir, les voisins vont défiler dans la maison et repartiront avec leur soupière pleine de soupe et, sur le couvercle, un morceau de boudin, le tout emmailloté dans le torchon à carreau. Dans quelques jours, c’est Yvette qui ira chez le voisin avec sa soupière… Cette tradition paysanne nouera des liens d’amitié et de solidarité dans nos campagnes.

En Périgord où le cochon était la viande par excellence, on n’employait pas le mot porc. On disait toujours le cochon ou, avec respect, Le Monsieur : « Lou Moussur ».
Le lendemain, dès huit heures, après un solide casse-croûte, Maurice le tueur procédera au découpage. D’abord les pattes, puis les quartiers de lard, la ventrèche, les filets et les côtes. Selon les désirs de la maîtresse de maison, les morceaux seront utilisés différemment d’une année sur l’autre. Avec le foie et du lard on fera du pâté. Pour l’andouillette, on prendra le gros intestin, l’estomac et de la couenne. Le cœur et les rognons finiront en brochette. La langue et les pieds cuits au court-bouillon se dégusteront froids en vinaigrette. La graisse découpée en petits dés cuira à feu doux quatre ou cinq heures dans le peyrol, avec les petits morceaux de viande pour les grillons. L’épaule découpée en morceaux servira pour les pâtés ou la chair à saucisse. Le filet deviendra enchaud et les côtelettes grillades. Quelques jours plus tard, le jambon sera mis au saloir avec le lard et la ventrèche.
Épilogue
Voilà goret pourquoi ils t’ont fait çà : pour se nourrir, tout simplement ! Dans toutes les fermes on élevait et tuait le cochon. Ici on sale, on fume, on stérilise, on fricasse, on mitonne, on ripaille, bref on périgorde ! Une cuisine sans beurre et sans reproche.
L’autre jour, si ça peut te consoler, j’ai vu passer une charrette tirée par Pompon en direction de Mauzac. Dans une cage en bois posée sur la charrette trônait la grosse, et tu sais quoi ? Il me semble bien qu’elle souriait.
Marcel Hitieu
Photos Jacky Schoentgen, coll. M. Gauthier.