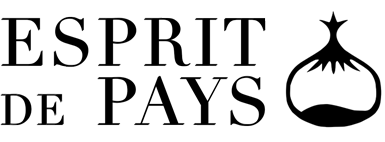Ce n’est pas seulement un pays où l’on mange bien, c’est aussi un pays où l’on mange finement et où la cuisine est tenue pour l’un des beaux arts. – André Maurois.
Le ‘Périgord passe pour avoir porté l’art culinaire à sa perfection tout en maintenant ses recettes traditionnelles rustiques, près du naturel et imprégnées des parfums du terroir’, ‘contrairement à la cuisine parisienne, bourguignonne ou lyonnaise, que les spécialistes qualifient volontiers de « cuisine bourgeoise », riche en tours de force techniques alors que la cuisine du Périgord dite « paysanne » s’enracine dans des recettes traditionnelles issues de son terroir. (1)
Depuis longtemps déjà, Périgord rime avec gastronomie grâce à ses recettes traditionnelles savoureuses… Dès le XVe siècle, les traiteurs de Périgueux et leurs pâtés périgordins sont célèbres au-delà de la province. L’un deux, un sarladais, M. Villereynier, fut anobli par Louis XV en signe de reconnaissance et de gratitude. Il devint Villereynier de la Gâstine, pâtissier du Roy (également orthographié Villereynier de la Gatine).
Pendant la Révolution, les maîtres-queux Lafon et Courtois continuent à fournir la France et l’Angleterre de leurs pâtés de perdrix farcies de foies de volailles et de truffes hachées, et plus tard de foie gras truffés suivant la recette de Close, célèbre cuisinier du Marquis de Contades, gouverneur de Strasbourg.
« Le meilleur guide de ma santé à table, c’est la volupté que j’éprouve en mangeant » aimait à dire Montaigne qui donna à la gastronomie périgourdine le beau titre de « science de gueule ».
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754–1838), diplomate et gastronome, et son cuisinier Antonin Carême, a également contribué à la renommée mondiale de la gastronomie périgourdine. Il est en effet notoire que la gastronomie périgourdine, parfumée au Monbazillac, fut un argument de poids dans les batailles diplomatiques que le « diable boiteux » livra avec succès pour le pays, ce qui contribua à rendre à la France post-révolutionnaire sa réputation de faste et d’hospitalité. Rappelons pour mémoire l’une de ses plus célèbres citations : « Le meilleur auxiliaire d’un diplomate, c’est bien son cuisinier ».
Au début du XXe siècle, Maurice Edmond Sailland, dit Curnonsky, humoriste et critique culinaire français, surnommé « le prince des gastronomes », dit du Périgord que c’est « une des régions de notre pays où l’on mange le mieux et depuis des siècles ». Aujourd’hui, en ces temps de redécouverte des saveurs authentiques, la cuisine périgourdine traditionnelle, fier de son terroir exceptionnel, jouit plus que jamais d’une réputation bien méritée.
Pourtant, comme le fait remarquer Georges Rocal dans son livre Science de gueule en Périgord, ‘ce serait une erreur de croire qu’en Périgord, on a toujours su cuisiner. La paysannerie n’en a pas eu les moyens pendant des siècles. Elle fut condamnée à se nourrir de choux rouges, de châtaignes, de raves, de fruits ; à boire piquette et eau fadasse ; à subir les famines consécutives des intempéries, des pluies, des sécheresses, provoquées encore par les guerres, tout d’abord contre les Normands, puis contre les Anglais, et ce, jusqu’à la Fronde’. (2)
Au début du XIXe siècle, si les paysans ne ressemblent plus à « des squelettes ambulants trouvant leur nourriture dans le sol et dans les herbes », comme le rapporte un témoin du XVIIIe siècle, ils sont néanmoins confrontés, le plus souvent, au manque plutôt qu’à l’abondance. Dans son livre intitulé La vie quotidienne en Périgord au temps de Jacquou le Croquant (2002), Gérard Fayolle explique que malgré le mieux-être apporté par la généralisation du maïs et l’introduction de la pomme de terre, les paysans du Périgord ne mangent pas à leur faim au début du XIXe siècle, la valeur nutritive de leurs aliments étant trop faible, et la malnutrition chronique. Des statistiques révèlent qu’entre 1815 et 1824, la population ne disposait que d’une ration moyenne quotidienne de 1 984 calories par tête, ce qui est nettement insuffisant puisque le seuil de la sous-alimentation se situe entre 2 000 à 3 500 calories.
Comprendre la cuisine périgourdine traditionnelle
La cuisine périgourdine traditionnelle est une cuisine paysanne, une cuisine faite de simplicité et d’authenticité. Ici, la sophistication n’est pas de mise. Les plats sont savoureux et bons, mais simples et traditionnels. Une cuisine rustique certes, mais une cuisine diversifiée, respectueuse des produits de son généreux terroir. C’est aussi une cuisine élaborée par des gens modestes qui ont appris l’art d’accommoder les restes. Ici rien ne se perd, tout se transforme et se décline… Et c’est enfin une cuisine de femmes… À ce propos, Michel Testut, dans son excellent livre, L’instinct de gourmandise en Périgord, déclare :
« La cuisine du Périgord est une cuisine de femme. Sa vraie nature est féminine : secrète, multiple, surprenante, voluptueuse, faussement simple. Dans les familles, la cuisine a toujours été une affaire de femmes qui ne regardent pas les hommes, ni d’ailleurs les autres femmes du voisinage. C’est ainsi que le foie gras ou le tourain blanchi n’ont jamais la même saveur d’une maison à une autre.
Autrefois, les recettes ne se donnaient pas à la légère, ne se vendaient pas. Non ! Les recettes se méritaient ou s’héritaient. Leurs secrets et leur tour de main, les filles les tenaient de leur mère et leurs mères de leur mère. Ce savoir-faire était un atout apprécié et faisait en quelque sorte partie de la dot de la jeune épousée. Ne disait-on pas qu’être bonne cuisinière était le plus sûr moyen de garder un hommes !
D’ailleurs autrefois, les femmes ne dévoilaient ni leurs genoux, ni leurs recettes… ». (3)
C’est après la guerre de Cent Ans que les femmes découvrent la cuisine, en louant leurs bras aux seigneurs locaux. Pour passer les longs mois d’hiver, elles apprennent également à conserver la nourriture. Le sel sert à conserver le jambon du cochon au saloir, tandis que la graisse d’oie enveloppe les quartiers de viande enfouis dans des pots de grès.
Ce savoir-faire — véritable patrimoine gastronomique – rythme encore, au fil des saisons, la vie de nombreuses familles périgourdines, avec la fête du cochon, la préparation des conserves, des bocaux, des confits… Une tradition qui se transmet fidèlement, de génération en génération, avec le savoir-faire qui l’accompagne.
Une cuisine de pauvre
Toutefois, il ne faut pas croire que les paysans mangeaient tous les jours à leur faim. « La Dordogne (du XIXe siècle), que dépeint le romancier (Eugène Le Roy), faisait encore partie d’une France sous-développée. La proportion de cultivateurs par rapport au total de la population active était forte ; malgré l’introduction plus ou moins réussie des plantes d’origine américaine, comme le maïs ou la pomme de terre, la productivité était toujours faible ; la pauvreté des paysans, qui n’était pas forcément la misère, engendrait une alimentation aux normes insuffisantes, d’autant que l’alcool faisait beaucoup de ravages ; ajoutons enfin que les maladies étaient plus répandues qu’ailleurs. » (1)
Toujours à propos de l’alimentation des classes modestes, voici ce que déclare Georges Rocal (1881-1967), prêtre et historien du Périgord, dans son livre « Croquants du Périgord » :
« Les périgourdins sont "amateurs de la table et de la bonne chair" ainsi que le constatait le Chevalier Lagrange Chancel au début du XVIIIe siècle. Ils ont rarement l’occasion de satisfaire leurs penchants gastronomiques. Les paysans ne sont pas assez fortunés et, même aisés, il pratique le régime sévère des ancêtres ; au reste la femme, occupée aux travaux des champs, n’a point le temps, ni le goût de cuisiner. Pour un jour de liesse et de ripaille, cent autres de sobriété. Le laboureur, avant de partir dès l’aurore sur les rastouls, casse une légère croûte avec les reliefs de la veille ou simplement avec un oignon, un piment largement salé ; puis il boit une décoction chaude et alcoolisée : une tisane de feuille de noyer ou désormais du café, noir de chicorée. À dix heures, il revient pour le repas. La faim le tenaille : « o un bedèu que japo, — ses entrailles jappent ». Une pitance, médiocre de qualité, pourvue qu’elle soit abondante, le satisfait. « Qui a talen, pas besoun de moustardo ». Les condiments, la moutarde, n’ajouteront rien à son appétit. « Tout fait ventre ! ». (4)
Signalons également le témoignage du marquis André de Fayolle qui écrivit, vers 1800, une étude intitulée Topographie Agricole du Département de la Dordogne, étude dans laquelle il décrit la nourriture des populations paysannes du département :
Leur nourriture varie suivant les climats et les différentes cultures du département. Dans les parties élevées, ils vivent principalement de châtaignes vertes et sèches, mangent du pain de seigle mêlé de balliarge et ne boivent pas de vin, excepté les jours de fêtes dans les cabarets. Dans les parties occidentales, ils se nourrissent mieux, surtout les propriétaires cultivateurs. Ceux-ci boivent du vin chez eux, mangent du pain de pur froment ou de seigle et froment, des châtaignes dans les pays où cet arbre réussit, du maïs en bouillie ou en gâteau, et presque jamais de viande. Ils accommodent et font leur soupe avec de l’huile de noix, mais ils se servent aussi de lard et de graisse.
Cette nourriture est la même pour les cultivateurs qui exploitent de bonnes métairies, mais elle est bien différente pour les ouvriers de la terre et les pauvres cultivateurs ; ils ne vivent que de châtaignes une partie de l’année, du pain de seigle mêlé de peu de froment, et de maïs. Dans les cantons où le seigle et le châtaignier ne sont pas cultivés, ils ne se nourrissent presque que de maïs, ne mangent point de soupe, ou seulement le matin à neuf heures ; tous leurs mets sont accommodés à l’huile de noix et, quand ils ne peuvent pas s’en procurer, le sel est leur seul assaisonnement. Dans le canton de Mussidan, l’huile de rave supplée à celle de noix (6).
Nous conclurons ce bref tour d’horizon des habitudes culinaires des périgourdins d’autrefois par le témoignage rapporté dans l’enquête statistique de Cyprien Brard. Réalisée en 1835, à l’initiative d’un préfet entreprenant, Auguste Romieu, cette enquête permet de se faire une idée assez précise de la vie en Périgord, au début du XIXe siècle. Citons l’un des commentaires relatifs à cette enquête concernant la nourriture en Ribéracois et en Nontronais – un passage sélectionné par Michel Combet et reproduit dans l’encyclopédie Régionale « Dordogne Périgord » :
La nourriture la plus ordinaire dans l’arrondissement de Ribérac se compose de légumes, de farine de maïs, quelques-uns y rajoutent de la viande ou du cochon salé. On peut conclure des réponses de 47 maires de l’arrondissement de Nontron que les légumes, la châtaigne et le maïs sont les principaux aliments du cultivateur ; dans douze communes, on y ajoute différentes préparations de farine de sarrasin, dans 13 communes on mange quelques fois de la viande et du cochon salé surtout pendant la récolte (7).
Sources et notes :
- (1) La cuisine rustique au temps de Jacquou le Croquant, Guy Penaud, José Corréa, Éditions La Lauze, 2004.
- (2) Science de gueule en Périgord, Georges Rocal, Éditions Pierre Fanlac, Périgueux, 1971.
- (3) L’instinct de gourmandise en Périgord, Michel Testut, La Lauze Editions, Périgueux, 2005.
- (4) Croquants du Périgord, Georges Rocal, Éditions Pierre Fanlac, Périgueux, 1970.
- (5) Croustet : morceau de pain entamé, de croûte principalement.
- (6) Dordogne Périgord, Michel Combet, Éditions Bonneton, Paris 1993.
- (7) Dordogne Périgord, Michel Combet, Éditions Bonneton, Paris 1993.
Crédit Photo : Soupe aux truffes noires VGE, by Classiccardinal, via Wikimedia Commons.