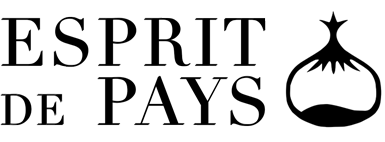Un air de Moravie en Dordogne
À découvrir aujourd’hui les photos heureuses des rives bergeracoises détenues par la Galerie Bondier-Lecat, qui pourrait imaginer pour un nageur comme moi toutes les résurgences qu’elles déclenchent sous les herbes longues et ondoyantes de la mémoire ?
À bien regarder ces corps allongés à la manière des tableaux impressionnistes de Manet ou de Renoir, comment ne pas apprécier le frémissement du noir et blanc et sa capacité à faire vibrer le grain d’une histoire familiale unique, la mienne.
Un long périple vers l’ouest l’avait éloigné de sa chère synagogue et du cimetière yiddish de Brno, ville bourgeoise bouleversée d’un coup par l’occupation allemande. Plus personne à voir flâner le long de la rivière. Plus de boutiques ouvertes tard en fin d’après-midi. Quelques rares cafés où les violons ont été rangés. Rien que les pas pressés de la peur et les raclements de gorge d’un hiver où le bois de chauffage et le charbon commençaient à manquer.
Ce dimanche allait être consacré une fois de plus à une sortie en canoë bien en amont du vieux pont, peut-être même à partir de Creysse. Les plus téméraires partaient de plus haut, vers Mouleydier, avec une lueur brillante de défi au creux des yeux. Le gagnant irait faire son Cyrano tard dans la soirée sur la piste de danse montée au pied de la vieille ville. Je n’étais pas de ces fiestas, trop attaché à travailler mes tonneaux et mes barriques dès le petit jour, sauf en été où je poussais jusqu’au bac de Sors fréquenté surtout par des habitués.
La neige avait déjà recouvert les quais de Krems si bien que le Danube montrait sa face grise, la plus inhospitalière, à l’opposé des couchers de soleil qu’il savait offrir en juillet lorsque nous quittions Vienne et ses splendeurs dans les années vingt. Loin de nos soucis, les fleuves de France se limitaient à la Seine, à la Loire, au Rhône et à l’estuaire de la Gironde. Nos valises pesaient encore plus sur nos pas glissants. Nous regardions souvent derrière nous. La police pouvait nous repérer à tout moment et nous interroger sur nos origines. L’esprit embrumé, nous trompions la faim avec du pain croqué à la sauvette. Nous devions absolument rester ensemble dans la fuite vers notre Israël utopique. « Avinu Malkeinu » nous tenait à la fois debout et silencieux.

Eh l’ami, un verre de Rosette ou de Pécharmant ? C’était des gars de la Poudrerie, des conducteurs de train, des manœuvres habiles, des petits commerçants, tout un monde enjoué qui venait se poser sur l’herbe douce avec femmes et enfants ou en célibataire blagueur et taquin. Chacun tombait la casquette, détendait les bretelles, défiait l’autre pour un plongeon dans la Dordogne et finissait par partager une cigarette. Parfois, un gars à la chemise bien blanche proposait un petit cigare dont le parfum de noisette grillée ondulait d’une nappe gourmande à la suivante. Une chanson fuse d’un coup sur trois notes lancées par un accordéon. Le refrain suit la brise qui arrive de Sainte-Foy et de Castillon-la-Bataille. Certains applaudissent ou sifflent entre leurs doigts. Les nouvelles du journal sont meilleures aujourd’hui et la prochaine vendange tiendra ses promesses.
Le piano n’avait pas suivi notre migration forcée. Seules, les partitions de « La Moldau » de Smetana, de chansons propres à la Moravie et d’airs colportés par Nochem Sternheim accompagnaient linges et vêtements en plus de nos photos de famille. Discrètement, en dépit de mes six ans, j’étais parvenu à glisser le livre de mon grand-père consacré à la pêche en eaux douces. J’y avais ajouté quelques lignes à gardons montées sur des supports en bois qu’il avait taillés au couteau. Une encoche recevait l’hameçon et préservait nos doigts d’enfants de ses piqûres douloureuses. Mon père parlait du lac de Genève, des « Reflets dans l’eau » de Debussy, de navigation sous le pont des Arts, d’écluses et de canaux…
Des silures de deux mètres ? Des gabares chargées de mille hectolitres de vin pour Bordeaux ? Des truffes grosses comme un ballon de rugby ? Les gamins d’Issigeac, de Lalinde et de Beaumont ont profité dans un premier temps de ma méconnaissance du français pour m’enseigner des fadaises de toutes sortes. Quelques mois plus tard, à la nuit tombante, ils m’emmenèrent près des grandes arches et m’enseignèrent longuement l’art de déclencher l’écho en criant des jurons. Cela tranchait tellement avec les longues marches sur les berges de cours d’eau inconnus que nous devions à tout prix traverser pour fuir les interrogatoires et la confiscation de notre culture si ancienne. À cette époque qui vit tant des nôtres prendre le chemin des camps, je n’accordais que peu d’intérêt aux textes de la Torah mais traverser les eaux noires du mépris et des injures habitaient mes rêves fréquemment.
La locomotive avait lâché un souffle irrespirable et brûlant en pleine voie à la hauteur de Saint-Laurent des Vignes vers 6 heures du matin. Le temps clair et la température douce nous avait posé sur les cailloux instables de la voie. Étrangement, aucun signe de bombardement possible, aucun uniforme hostile. Nous pouvions choisir enfin un lieu où nous poser. Nous étions à court d’argent et d’optimisme. Toutefois, peu à peu, la fin de la guerre parvint sur cette belle terre d’accueil. Après quelques démarches infructueuses auprès de la sous-préfecture, la communauté religieuse de La Madeleine nous accueillit avec bienveillance. Grâce aux soins prodigués par les sœurs infirmières, Samuel R., citoyen presqu’apatride, mon père, toussait beaucoup moins et prit le temps de se détendre en fermant les yeux. C’est ainsi qu’il s’attacha aux pierres blondes des bâtisses périgourdines.
Ces variations de l’eau rétablirent auprès de notre famille le goût de la musique et de la fête. Les terres chaudes des prés et des vignes qui finissent toujours par glisser dans la Dordogne nous apaisèrent au fil des années. Mon père devenu professeur de musique découvrit les vertus des heures passées à guetter un bouchon de couleur sans aucune appréhension tout en égrenant suavement la mélodie d’« Au bord de l’eau » de Gabriel Fauré. Il y ajouta aussi le plaisir de la photographie familiale. Les pages de guerre s’éloignèrent ainsi grâce aux vertus de l’amitié. Les dimanches au bord de l’eau devinrent une habitude de joie partagée. La grande rivière nous avait fait pour longtemps l’immense cadeau de la fraternité.
Rémy Cassal, Couze et Saint-Front, Novembre 2017
© Photos
Collection Bondier-Lecat