C’est en 2006, lors des travaux réalisés aux abords de l’église romano-bysantine Saint Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Côle (XIIe siècle) que sont mises à jour quatre logettes à répit accolées à la chapelle sud. Des ossements sont découverts dans la terre qui remplit deux de ces sépultures. Il s’agit de restes humains de petite taille. Ce n’est qu’en 2011 que des spécialistes en paléopathographie ont ainsi pu identifier le squelette d’un enfant âgé de trois ans et d’un nouveau-né. Que nous apprennent ces logettes à répit ?
Depuis 1862, l’Église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Côle est classée à l’inventaire des Monuments Historiques. Construit sur la place du village, à la fin du XIe siècle, cet édifice est intéressant à plus d’un titre. Entre autres choses, elle est caractérisée par un plan unique en Périgord. Elle se compose d’une seule travée, carrée, suivie d’une abside entre deux chapelles rayonnantes. Cette travée carrée était à l’origine surmontée d’une coupole imposante de 12,60 mètres de diamètre, aujourd’hui remplacée. Pour en savoir plus, voir l’encadré en bas de page.
 Les logettes à répit sont situées à l’extérieur de l’église Saint-Jean-Baptiste, le long d’un mur de la chapelle sud, juste derrière la halle en bois qui servait de « caquetoire », le plus souvent après la messe. Voici la description qui en est faite dans l’Étude des ossements des sépultures à répit de l’église Saint Jean Baptiste de Saint-Jean-de-Côle publiée par La Pierre Angulaire et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Dordogne (C.A.U.E. 24) :
Les logettes à répit sont situées à l’extérieur de l’église Saint-Jean-Baptiste, le long d’un mur de la chapelle sud, juste derrière la halle en bois qui servait de « caquetoire », le plus souvent après la messe. Voici la description qui en est faite dans l’Étude des ossements des sépultures à répit de l’église Saint Jean Baptiste de Saint-Jean-de-Côle publiée par La Pierre Angulaire et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Dordogne (C.A.U.E. 24) :
Les logettes à répit sont de petits sarcophages anthropomorphes, de la taille d’un nouveau-né, creusées directement dans la pierre granitique du dallage extérieur, contre le mur gouttereau du chœur de l’église. La tête est orientée à l’ouest et les pieds à l’est. Elles sont au nombre de quatre, de taille différentes alignées contre le mur sud de l’édifice. La première, la plus petite mesure 50cm de long sur 20cm de large, d’une profondeur de 11,5cm. La deuxième, la plus grande, 100cm sur 27cm dans sa partie la plus large, d’une profondeur de 15cm. La troisième, 64cm sur 19cm, dans sa partie la plus large, profonde de 12cm La quatrième, 82cm sur 20cm, profonde de 13cm. À l’origine, ces logettes étaient recouvertes d’une pierre tombale. Seule la quatrième logette possède une partie de cette pierre, sans que l’on puisse être sûr qu’elle soit d’origine. Elle mesure 63cm sur 32cm, avec une épaisseur de 15cm (1). — N.B. : les largeurs sont prises au niveau des épaules (distance la plus grande).
De nombreuses questions se posent concernant ces quatre logettes à répit ? Quel était leur usage ? Pourquoi une tombe d’un mètre de long se trouve au milieu de tombes de petites tailles, réservées aux nouveaux-nés ou mort-nés non baptisés ? Et pourquoi y a-t-on trouvé les ossements d’un jeune d’environ trois ans ?
L’histoire des logettes à répit
Pour expliquer l’existence de ces logettes, il faut comprendre l’importance accordée au baptême chez les Catholiques, surtout au Moyen-âge. Ce sacrement – qui ne peut être administré qu’à des êtres vivants – permet d’accéder au Paradis. Or, au Moyen-âge, la mortalité infantile est très importante et, de ce fait, constitue une préoccupation majeure pour les populations. Souvent les enfants meurent avant même que les parents aient pu les faire baptiser, sans parler des enfants morts-nés. Sans le sacrement du baptême qui conférait un statut au nouveau-né, pas de place pour eux au Paradis, ni en Enfer, et pas davantage au cimetière, terre consacrée. C’est au XIIe siècle que les théologiens inventent les Limbes (Limbus puerorum), un concept censé résoudre ce « problème ». Mais cette « solution » n’a pas su répondre à l’angoisse des parents qui doivent, d’une part, supporter la séparation physique d’avec leur enfant et, d’autre part, accepter l’idée de ne pas les revoir dans l’« autre monde », puisque les Limbes ne communiqueraient ni avec le Purgatoire, ni avec le Paradis. D’autre part, elles priveraient l’enfant de la vision de Dieu. Cette perspective leur est d’autant plus insupportable que l’Église avalise une autre croyance, bien différente, pour les jeunes enfants baptisés qui décèdent avant l’âge de sept ans : eux peuvent aller directement au ciel, car ils sont déclarés sans péché. Devenus anges, ils peuvent alors assurer le salut de leurs parents. La mort d’un enfant baptisé est donc un gage d’espérance célébré par des chants d’action de grâces. Dans le rituel pas de noir, mais du blanc, pas de glas, mais un carillon joyeux. Il en va tout autrement lorsque la mort surprend le nouveau-né qui n’a pas reçu le baptême puisque les parents se voient refuser à la fois l’existence terrestre et l’éternité bienheureuse (2).
« Si la sérénité finit par gagner peu à peu les familles qui ont perdu un tout-petit après le baptême, il n’en est pas de même pour celles qui n’ont pas pu le baptiser. Sans baptême, les petits morts qui n’ont pas reçu de nom, ni de parents spirituels, ne sont intégrés ni à la communauté des morts ni à celle des vivants. Leur corps ne peut être enterré dans le cimetière paroissial en terre consacrée ; ils sont inhumés n’importe où, comme des animaux, au pire dans un champ où leur corps servira à « engraisser les choux », au mieux dans le jardin familial ou dans un coin non consacré du cimetière. Comme celles des disparus en mer, des suicidés et des assassinés, leurs âmes, insatisfaites, ne peuvent trouver de repos : elles errent autour des vivants qu’elles reviennent sans cesse tourmenter. » – Marie-France Morel, La mort d’un bébé au fil de l’histoire (2).
La croyance populaire pallie ce traumatisme par une stratégie de substitution : le « répit », autrement dit le miracle du retour temporaire de la mort à la vie des morts-nés. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les sanctuaires à répit et les logettes à répit.
Les sanctuaires à répit
Face à la mort trop évidente de leur nouveau-né, les parents désemparés n’ont d’autres recours que de porter la petite dépouille dans un lieu de pèlerinage réputé et consacré, le plus souvent, à la Vierge, dont l’intercession est nécessaire pour obtenir un miracle. Là, famille, fidèles et clergé local implorent la grâce divine dans l’espoir qu’il revive un court instant, le temps de recevoir le baptême. En France, il existait près de 280 sanctuaires à répit (3).
Les supplications de la mère poussaient des proches, accompagnés d’un parrain et d’une marraine, à transporter le petit cadavre jusqu’à un sanctuaire à répit. L’enfant mort-né était souvent apporté dans les heures suivant l’accouchement. Arrivé au sanctuaire, le corps du bébé était exposé sur un autel, le plus souvent celui de la Vierge. Dès lors, des prières ferventes étaient psalmodiées par tous les assistants, auxquels se joignent généralement un ou plusieurs prêtres attachés au sanctuaire. Tout le temps de l’exposition, l’assistance guettait un signe de vie : un épanchement, une chaleur, une couleur vermeille qui montait au visage, un membre qui semblait bouger. Quelquefois, on plaçait une plume sur les lèvres du bébé et le mouvement de l’air provoqué par la chaleur des cierges laissait croire qu’il se mettait à respirer. Si l’un de ces événements survenait, le répit ne durant que quelques minutes, l’enfant était immédiatement baptisé par un des prêtres présents et l’enfant, devenu chrétien, entrait dans le sein de l’Église. – Jacques Gélis, Les enfants des limbes (4).
Les logettes à répit
Précisons tout d’abord que le village de Saint-Jean-de-Côle n’abritait pas de sanctuaire à répit, mais bien des logettes à répit. Ajoutons ensuite qu’en Europe ces logettes étaient beaucoup plus rares que les sanctuaires. Ceci étant dit, intéressons-nous maintenant au cas de Saint-Jean-de-Côle.
L’enfant mort sans avoir été baptisé est placé dans la logette, au plus près du chœur de l’église dont le saint patron est Saint Jean-Baptiste, celui qui baptisa le Christ. La pluie, eau purificatrice qui tombe du ciel, ruisselle sur le toit du Chœur avant de tomber sur la logette contenant le corps enseveli du jeune enfant. Au bout d’un an, on considère le baptême comme effectif, grâce à cette eau sanctifiée. Après ce baptême de substitution, l’enfant a un nom : dès lors, il peut être réintégré dans la communauté des chrétiens, et enterré au cimetière paroissial. Et les parents peuvent enfin faire leur deuil, en toute quiétude.
D’autres formes « sauvages » de répits consistaient parfois à enterrer le nouveau-né sous une des gouttières de l’église, de manière à ce que, constamment lavé par l’eau ruisselant du bâtiment sacré, il finisse par obtenir des grâces analogues à celles du baptême. – Marie-France Morel, La mort d’un bébé au fil de l’histoire (2).
Une pratique condamnée, mais tolérée
Dans un premier temps, à la fin du Moyen Âge, en raison de la large audience de la doctrine augustinienne, l’Église encourage les répits en imposant la nécessité du baptême comme condition du salut a toujours été réaffirmée. Le phénomène des sanctuaires et des sépultures à répit connaît son apogée entre le XVe siècle (pendant la Réforme catholique, le Concile de Trente) jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Puis, peu à peu, la pratique du répit – né des croyances et rituels populaires – est mal vue par la curie romaine qui la qualifie de superstition et, suivant les époques et les lieux, les évêques la condamnent ou la tolèrent. Localement, il est condamné par le synode de Langres de 1452 et le synode de Sens de 1524. Les évêques de Lyon (1577), de Besançon (1592 et 1656), de Toul (1658) dénoncent eux aussi ces répits. Ce n’est que très tardivement que la papauté interdit officiellement cette pratique par le décret du 27 avril 1729. Cette interdiction est confirmée en décembre 1729, puis en 1737, en 1744, en 1751 et en 1755.
Malgré la multiplication de ces rappels, Rome ne parvient pas à éradiquer cette tradition. Pourquoi ? Non seulement parce qu’elle est trop enracinée dans les pratiques populaires, mais aussi parce qu’elle est tolérée par le clergé local, plus sensible au désespoir des parents qu’ils fréquentent. C’est ainsi que le répit à perdurer sur une période d’au moins sept siècles, du Moyen-âge à la Première Guerre mondiale, plus particulièrement en Provence, Limousin, Auvergne et Bourbonnais. De ce fait, des milliers de familles ont été concernées, « même s’il est évident que la plupart des mort-nés n’étaient pas portés au répit », précise Jacques Gélis (4).
Découverte des logettes à répit de Saint-Jean-de-Côle
Jusqu’en 2006, ces logettes étaient remplies de terre et pratiquement invisibles. En effet, la pratique du répit étant tombée en désuétude, et la présence des logettes était complètement ignorée de l’histoire locale. C’est grâce au Docteur Philippe CHARLIER, médecin légiste et paléopathologiste, en visite à Saint-Jean-de-Côle, que l’on a redécouvert l’usage oublié de ces logettes. Pour info, le Docteur CHARLIER et son équipe ont authentifié quelques ossements de personnages historiques célèbres comme les ROMANOV, le crâne d’Henri IV, les restes d’Agnès SOREL…
C’est donc en nettoyant les logettes à répit de Saint-Jean-de-Côle que des ossements furent découverts dans l’une d’entre elles. Il s’agissait de restes osseux de deux individus différents, chacun incomplet. En 2011, ils ont été examinés par une équipe spécialisée dans la paléopathographie. Les ossements du premier, trop peu nombreux, ont simplement révélé qu’il s’agissait d’un nouveau-né. Les ossements du deuxième, plus complet, ont pu être étudié. Ce squelette était celui d’un enfant de trois ans environ, atteint de rachitisme. Ce qui est bien tardif pour un enfant non baptisé. Dans son Étude des ossements des sépultures à répit de l’église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Côle, Charles Georget formule plusieurs hypothèses pour expliquer pourquoi un enfant de 3 ans se trouve inhumé à cet endroit.
- Il s’agirait d’une tombe de jeune enfant placée au milieu des sépultures à répit, mais aucun écrit ne confirme cette thèse.
- Il peut tout simplement s’agir d’une réutilisation de ces tombes à répit pour déposer des ossements en position secondaire donc comme ossuaire. Des fouilles plus étendues autour de l’église permettraient peut-être de localiser des sépultures primaires d’un cimetière paroissial plus ancien.
- Selon les témoignages d’habitants de la région, il se dirait qu’une sépulture « contenait un enfant plus grand que les autres. Il s’agissait peut-être d’un enfant caché, bâtard ou malformé. Il était fréquent à la campagne de dissimuler les naissances « honteuses » »… mais cela est-il une légende ? (1)
Quand sont-ils morts ? Aucun registre paroissial mentionnant la date d’une inhumation dans une sépulture à répit n’a été retrouvé à Saint-Jean-de-Côle. Seule une datation au Carbone 14 pourrait dater ces décès avec fiabilité.
L’église romane Saint Jean-Baptiste
Construite à la fin du XIe siècle, vers 1083, sur ordre de Raynaud de Thiviers, alors évêque de Périgueux, l’Église de Saint-Jean de Côle, devenue église paroissiale au fil du temps, est en fait l’ancienne église du prieuré. Elle est placée sous le patronage de Saint-Jean Baptiste. La construction de cet édifice, parfaitement orienté, possède un plan insolite, unique en Périgord et peut-être même en France. L’église semble s’organiser en demi-cercle autour de l’abside, puisque la nef est constituée d’une seule travée carrée, surmontée à l’origine d’une coupole. Cette coupole a disparu une première fois pendant les guerres anglaises, puis a été reconstruite, vraisemblablement avec beaucoup de difficultés si l’on en juge par les renforts qui ont été apportés aux piliers d’origine, pour éviter l’écroulement de l’ensemble sous le poids. Possédant un diamètre de 12,60 mètres, cette coupole était la seconde du Périgord, derrière celles de la Cité, à Périgueux, qui mesure 13 mètres, et avant celles de la cathédrale de Saint-Front, toujours à Périgueux, qui ne mesurent qu’un peu plus de 11 mètres. On peut ainsi imaginer le poids de cette coupole, construite avec les matériaux relativement lourds de l’époque et reposant sur les quatre piles, écartelées par la poussée de l’édifice, d’autant plus que les chapelles installées dans les grands arcs ont affaibli leur résistance. Visible sur une gravure du XVIIIe siècle, qui est le seul document qui en témoigne, la coupole s’est effondrée en 1787, puis à nouveau en 1860, après sa reconstruction. (5)
Notes :
- (1) Étude des ossements des sépultures à répit de l’église Saint Jean Baptiste de Saint-Jean-de-Côle, Dossier d’Inventaire Petit Patrimoine Architectural du Périgord, édité par La Pierre Angulaire et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Dordogne (C.A.U.E. 24), Nicole Fournier, M. Charles Georget.
- (2) Marie-France Morel, La mort d’un bébé au fil de l’histoire.
- (3) Hélène Romano, L’enfant face à la mort.
- (4) Jacques Gélis, Les Enfants des limbes. Mort-nés et parents dans l’Europe chrétienne.
- (5) L’église romano-bysantine Saint Jean-Baptiste, www.ville-saint-jean-de-cole.fr.
Crédit Photos :
- L’église et la halle de Saint-Jean-de-Côle, by Père Igor (own work), via Wikimedia Commons.
REMARQUE : Si un extrait du présent article posait problème à son auteur, nous lui demandons de nous contacter et cet article sera modifié dans les plus brefs délais.
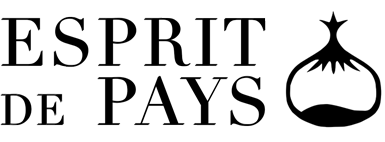











Article très intéressant et très instructif.
Dommage pourtant de classer cette belle église romane dans le style « romano-byzantin » (St-Front, par exemple) qui relève de la tendance à l’éclectisme du XIXe siècle qu’on aime ou pas.
Merci.
Bonjour et merci pour l’intérêt porté à cet article. Merci également pour votre remarque. Jean secret ne fait pas mention du style byzantin lorsqu’il décrit cette église romane. Pourtant, c’est la remarque que l’on trouve sur certains guides touristiques comme le guide Lonely Planet « Dordogne Lot », édition 2016, ou bien encore « Lieux insolites et secrets du Périgord », de Christine Ribeyreix, aux Éditions Patrimoine Gisserot. Dans le doute, je modifie mon texte… et je ferai des recherches plus poussées ultérieurement.
Il semblerait qu’il faille distinguer l’époque romano-byzantine datant du onzième et douzième siècle et le renouveau de cet art au XIXe siècle puis au XXe siècle.