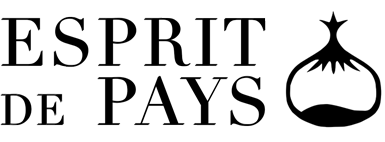Jusqu’au milieu des années soixante, on ne se doutait de rien. Il n’y avait, d’ailleurs, aucune raison de se méfier de quoi que ce soit. Bellecombe était un petit village du Périgord Noir qui vivait au rythme des saisons.
Nous avions besoin de peu et nous étions heureux. De chaque maison, de chaque échoppe montaient les bruits de la vie. Les « pan, pan, pan » du menuisier répondaient aux « ping, ping, ping » du maréchal-ferrant. À la terrasse du Café des Platanes, les anciens commentaient l’actualité en langue d’oc, en jouant aux cartes et en sirotant du Bartissol… Mathilde passait de maison en maison pour colporter les commérages. Cette ancienne lavandière avait un don particulier pour transformer un fait divers banal en évènement exceptionnel. Au salon de coiffure, les dames commentaient la vie des vedettes. Ainsi, pour le prix d’une mise en plis ou d’un crêpage de chignon (au sens premier du terme) on ne pouvait ignorer que Brigitte Bardot avait quitté Serge Gainsbourg pour épouser un millionnaire autrichien du nom de Gunther Sachs, ou encore que le beau Johnny Hallyday envisageait de convoler en justes noces avec Mademoiselle Sylvie Vartan. Momo le Nèche, c’est-à-dire le simple d’esprit, balayait les feuilles tombées des platanes en fredonnant quelques vieilles chansons du répertoire. Du matin au soir, du chant du coq à celui du rossignol, la musique du village nous jouait la symphonie des gens heureux.
Nous, pendant ce temps, on jouait du blues ! Quand je dis, « nous », je parle des jeunes gars que nous étions à l’époque. On jouait du blues dans une des anciennes classes de l’école publique qui, déjà, avait perdu un instituteur. Nous nous acharnions sur nos guitares et nos amplis à reproduire les morceaux de John Lee Hooker, de Chuck Berry ou bien d’Elvis Presley… Pour imiter les Beatles, on se laissait pousser les cheveux par-dessus les oreilles, au désespoir de nos parents qui voyaient, dans ces débordements capillaires, poindre la décadence sur le crâne de leurs chers petits.
Et puis un jour… Une grosse voiture noire aux vitres teintées et aux chromes rutilants est arrivée, a traversé lentement la place pour venir se garer devant l’Hôtel des Platanes. Lorsque l’étincelante automobile s’arrêta devant la terrasse, le silence tomba subitement sur la place. La portière côté conducteur s’ouvrit lentement, comme dans un film américain. On vit apparaitre une, puis deux chaussures vernies noires et un pantalon blanc. L’homme, séduisant comme un acteur d’Hollywood, fit le tour de l’auto et vint ouvrir la portière à une créature hollywoodienne elle aussi. Jupe fendue, souliers crocos, chevelure blond-platine, tailleur rose élégant. Cette double apparition passa devant les vieux joueurs de cartes sans leur prêter la moindre attention et se dirigea vers le comptoir. Immédiatement, Fernand, le patron, retira son tablier crasseux, ajusta sa chemise dans son pantalon, releva ses cheveux d’un geste énergique et se fendit d’un mot d’accueil :
– Madame, Monsieur… Bienvenue dans mon modeste établissement ! Vous souhaitez prendre un rafraichissement peut-être ?
– Oui mon brave, mais pas seulement ! Auriez-vous une chambre pour quelques jours ?
Fernand faillit s’étrangler. Accueillir chez lui des gens d’une telle élégance ! Il pensa immédiatement que lorsqu’il allait leur montrer les cambuses, ils allaient illico tourner les talons. Pas du tout ! Lorsqu’il leur ouvrit la plus belle de ses chambres, ils trouvèrent cela « charmant, pittoresque, typique, original » ! Ils employèrent d’autres mots encore que Fernand ne comprit pas tout à fait. Il descendit et remonta les escaliers plusieurs fois pour amener les bagages de ses hôtes. Avant de fermer la porte, l’homme le prit par le bras et lui dit sur le ton de la confidence :
– Cher monsieur, votre maison, c’est exactement ce que nous cherchions. Un établissement authentique, comme autrefois, au cœur d’un village comme il n’y en a plus. Vous comprenez… Nous cherchons la Vérité dans ce monde de fous. Nous avons de l’argent, des voitures, des appartements. Mais l’Authentique, voilà ce qui nous manque. L’Authentique ! Et le Silence. Nous rêvons de Silence ! Notre vie n’est qu’un tourbillon de bruits, de vociférations, de tapage, de chambard, de raffut, de vacarme. Mais nous en sommes certains, nous venons de trouver ce que nous cherchons : le calme, la tranquillité, la paix, la sérénité. Le Silence ! Le Silence !
– Ah ! pour ça Monsieur, vous avez trouvé le bon endroit ! Ici, pas d’usine, pas d’autoroute, pas de bruit… Vous allez être au Paradis, Monsieur, au Paradis !
Et Fernand est revenu à son comptoir avec l’air supérieur de ceux qui savent parler à la clientèle. Ça n’a pas duré longtemps. Fernand essuyait ses verres en gonflant un peu la poitrine lorsque l’homme est apparu en haut de l’escalier.
– Monsieur Fernand, vous pouvez monter s’il vous plait ?
Il s’est précipité comme le valet de pot du roi Louis, en courant.
– Cher Monsieur Fernand, comment dire, vous nous aviez promis le silence et là… Il y a sous la fenêtre, un quatuor de vieilles personnes qui braillent en jouant aux cartes, dans un sabir incompréhensible ! Sûrement des émigrés, on ne comprend même pas ce qu’ils racontent… C’est insupportable !
– Mais, cher Monsieur, ce ne sont pas des émigrés ! Ce sont les plus vieux du village : ils parlent dans la langue du pays. C’est du patois, de l’Occitan !
– Écoutez… Occitan, Breton ou Corse, que m’importe ! Je veux du silence. Qu’ils se taisent !
– Ouh ! Mais ça va être dur de les faire taire. Vous comprenez, ils ont l’habitude de…
– Moi aussi, j’ai l’habitude, coupa l’homme en souriant. Voilà quatre cents francs. Je suis sûr que ça va les aider à faire silence.
Fernand a pris les billets et est allé voir les vieux. Il leur a expliqué que s’ils se taisaient, le voyageur leur donnerait cent francs à chacun. Avec un peu de chance, ça pouvait recommencer le lendemain. Les vieux n’ont pas hésité une seconde. Ils ont pris les billets, replié le tapis de cartes et sont allés au comptoir entamer, sans faire de bruit, cette sorte de retraite complémentaire inattendue. Mais du coup, on a clairement entendu, les « pan, pan, pan » du menuisier et les « ping, ping, ping » du maréchal-ferrant. Le vacancier rappela Fernand qui repartit avec quelques billets en poche, en direction de la menuiserie et de la forge qui devinrent silencieuses en un instant. C’est à ce moment-là, qu’on a discerné la voix très haute de Mathilde qui racontait comment la fille de Marcillac avait passé la nuit dans la cabane de Rassoulières. Fernand la fit taire avec une somme un peu supérieure au prix du marché. De fil en aiguille, on a vu arriver le Fernand jusqu’à notre salle de répétition.
– Dites donc les gars, vous jouez fort, non ? Vous ne pouvez pas baisser un peu ?
– Fernand, le rock et le blues, ça se joue à pleine patates sinon, vaut mieux s’arrêter ! Et ça, tu vois, pour nous faire arrêter, faudrait nous payer cher !
C’est ce qu’il a dû faire, parce qu’on a rangé les guitares et éteint les amplis en regardant la liasse qu’il venait de nous remettre. On s’est assis sur les marches de l’école et on a commencé à dire du mal des autres… pour passer le temps.
Vers sept heures du soir, le jour commençait à décliner et le silence était à peu près complet sur la place du village. Fernand était content, parce que ses illustres clients pouvaient, enfin, goûter la quiétude qu’ils étaient venus chercher et qu’ils avaient chèrement payée aux gens du cru. Mais sept heures, c’est aussi l’heure à laquelle Momo le Nèche rentre du boulot et passe arroser ça au Café des Platanes. Et Momo, il chante tout le temps. Quand il embauche, quand il travaille, quand il débauche. Un imbécile… Mais un imbécile heureux ! Il chantait une vieille chanson qui parlait d’une perdrix grise :
– Si je savais voler comme la perdrix grise. Se ieu sabiai volar…
Fernand s’est jeté sur lui en lui intimant l’ordre de se taire.
– Et pourquoi je me tairais ? Il y a quelqu’un de mort ?
– Mais non… Il y a un type qui nous paye pour qu’on ne fasse rien et qu’on fasse du silence.
– Ça doit être malhonnête ça… Si je veux chanter, je chante et puis c’est tout !
Alors, à trois ou quatre costauds, ils l’ont chassé à coup de pieds aux fesses. Momo était furieux et faisait des bras d’honneur en s’éloignant.
– C’est malhonnête je vous dis !
Et ensuite, on l’a eu à plein régime, le silence. Un silence de mort ! Il n’y avait pas vraiment de mort, comme s’en inquiétait Momo, mais c’est tout le village qui semblait trépassé. Ce soir-là nous avons dîné sans faire de bruit, barricadés dans nos maisons. Parce que chez nous, on a une conscience aigüe de l’honneur. Quand on nous paye pour quelque chose, on respecte le contrat.
Vers minuit, Fernand était sur son lit et faisait le bilan de la journée. Il avait obtenu quatre cents francs pour les vieux, quatre cents pour le menuisier, cinq cents pour Mathilde et les jeunes, et ceux-là, et ceux-là… Une belle journée !
– Si on ne fait pas les couillons, on peut gagner gros, en ne faisant plus rien. Il se disait que, pour une fois, la chance tombait sur Bellecombe. Il se voyait même se faire porter maire aux prochaines élections. Parce qu’enfin, c’était un peu grâce à lui que l’argent tombait sur Bellecombe !
Et soudain… Patatras ! Dehors, dans le noir, sur la place… là… Devant chez lui… Le rossignol s’était mis à chanter… « Cui, cui, cui ! » Magnifique, mais insupportable. Fort ! Très fort ! « Aquela puta de rossinhól ! »
Fernand s’est rué sur son fusil. Un douze qu’il garde au pied du lit « en cas des voleurs » comme il dit. Il ouvre les contrevents. L’oiseau moqueur était là, sur le premier platane devant la fenêtre. Fernand enfile deux cartouches dans le canon :
– Toi, je vais te réduire en steak tartare ! Vas veire ! Mais au moment de tirer, il se ravise. Impossible de déchirer le silence avec deux coups de fusil dans la nuit. Il referme la fenêtre et descend l’escalier sans faire de bruit et lorsqu’il ouvre la porte… Nous étions là, tous les habitants du village, pétrifiés devant cet oiseau qui risquait de nous faire perdre beaucoup d’argent en ne respectant pas le pacte du silence sur lequel nous nous étions engagés. On se regardait, et on regardait l’oiseau. On se regardait, et on regardait l’oiseau qui chantait, à tue-tête ! Nous étions désemparés devant tant d’insolence. Comme pour ajouter un peu au drame, une voix sortit du noir, dans un coin de la place. Une voix que nous connaissions bien et qui nous interpellait :
– Couillons, et oui, vous êtes des couillons !
Nous avons tout de suite reconnu la voix de Momo le Nèche. D’habitude, c’est nous qui le traitions de couillon. Mais là…
– Vous êtes des jolis couillons, plantés sous le platane. Mais regardez-vous ! Et regardez-le, l’oiseau… Vous savez la différence qu’il y a entre lui et vous ? La différence c’est que lui, il est libre !
On peut dire que ça nous a fait un choc ! Alors, c’est nous, les jeunes du village, qui en premier, avons sorti nos instruments : une guitare, un tambourin, une chanson… La perdrix grise justement ! « Se ieu sabiai volar », en occitan. Momo s’est mis à chanter avec nous. Mathilde aussi ; le menuisier a commencé à taper sur une table de la terrasse avec un bâton et le maréchal-ferrant, et tout le monde tapait ! Sur des boites, des casseroles, des bouteilles. Le charivari ! La fenêtre de la chambre des voyageurs s’est ouverte :
– Taisez-vous ! Mais taisez-vous ! Vous êtes payés pour faire silence.
On a chanté et tapé encore plus fort. Puis on a mis tous les billets qu’ils nous avaient donnés dans une boite et lorsqu’ils sont passés au milieu de nous, on leur a rendu l’argent. On a vu disparaitre dans la nuit les deux petits points rouges des feux arrière de la belle voiture noire. Personne n’avait envie d’aller se coucher, alors pour fêter ces retrouvailles avec nous-même, on a fait la fête toute la nuit. Fernand était un peu chagrin, mais après deux coups de rouge il a retrouvé sa joie de vivre.
Curieusement, le village a retrouvé son agitation et son calme en même temps. Mais à bien y réfléchir, ce soir-là, on a surtout retrouvé… notre dignité.
Jean Bonnefon
Illustrations : Francis Pralong