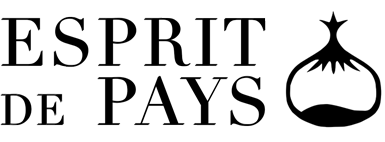« Un foyer ne doit pas être un lieu où l’on séjourne, mais un lieu où l’on revient. » – Henri de Montherlant.
L’autorail crème et rouge s’ébranla en tremblant, les vieux moteurs diesel hoquetèrent, puis le train prit un peu d’élan jusqu’au premier changement de vitesses. Après plusieurs tentatives et quelques soubresauts, les pignons finirent par s’enclencher et le convoi prit son régime de croisière.
Il régnait une douce torpeur dans le wagon. Les passagers, pour la plupart des étudiants qui rentraient chez eux en ce vendredi de février 1976, parlaient doucement ou somnolaient, tout comme notre héros. Il devait avoir 18-19 ans. Brun, mince, il portait un 501 délavé, des Clark usés, un pull marin bleu boutonné sur l’épaule et une parka kaki. Au-dessus de lui, sur les porte-bagages chromés, un vieux sac à dos défraîchi laissait pendre ses courroies effilochées. Dans la nuit froide, les réverbères lançaient leurs lumières jaunes contre les vitres embuées. Il essuya la glace. La voie suivait la route bordée de platanes qu’empruntaient les feux rouges des voitures. Bientôt ce serait la grande usine illuminée, puis l’avant-dernière station. Il avait quitté la côte basque vers seize heures, il devait être environ vingt heures trente.
Puis ce fut le stade, avec sa petite tribune, la piste d’athlétisme, la haie de thuyas dans laquelle il se cachait avec ses camarades pour échapper aux courses « d’endurance » du professeur de gym. Il sourit. Ce temps-là n’était pas si lointain.
Le conducteur lâcha un coup de klaxon, les freins sifflèrent, il était arrivé. Portant son sac par les bretelles, il traversa la gare. Immuables, les affiches promotionnelles du Lioran ornaient les murs jaunes. Il reconnut quelques amis qu’il n’avait pas vus dans le train. On lui proposa de le ramener, mais il refusa poliment, prétextant qu’on venait le chercher.
Dehors il faisait froid. Les dernières R16, DS et 404 quittaient la place. Il ferma sa parka, ajusta son sac à dos, prit la rue de la gendarmerie, puis il obliqua à gauche vers la passerelle du canal.
C’était son pays. Il connaissait chaque mètre de bitume, chaque arbre, tout lui était familier. Il aurait souhaité prendre tout cela de haut, être un peu d’ailleurs maintenant qu’il vivait dans des contrées lointaines, et rester impassible face aux sentiments qui l’assaillaient, mais rien ni faisait : il se sentait l’âme joyeuse à l’idée de parcourir les quelques kilomètres qui le séparaient encore de sa famille.
Après avoir traversé le canal, il longea le bassin, prit la rue qui menait vers l’église et s’engagea sur le pont. Les eaux sombres du fleuve charriaient des tourbillons, irisés par les néons des réverbères. Plus haut en amont, il distingua les îlots noirs et les reflets luisants des rapides. La lune se levait maintenant au-dessus des crêtes.
La départementale suivait quelque temps les coteaux boisés qui, l’hiver, ne voient presque pas le soleil, avant d’obliquer vers la rivière. Il n’aimait guère cette portion du trajet. Il continua, au carrefour jadis bordé de grandes sapinettes, sur la petite route qui monte vers l’arrière-pays. Les talus étaient couverts de touffes de perce-neiges. Le gel commençait à se former et de petits grains de givre apparaissaient au bout des tiges.

À l’embranchement redescendant vers le village, il choisit d’escalader le coteau abrupt. Un petit sentier conduisait à travers la lande d’herbe sèche et de genièvres en haut de la colline. Au fur et à mesure qu’il grimpait, la végétation se densifiait, des chênes, des sorbiers et des alisiers se mêlaient aux épines noires pour former des taillis épais, impénétrables. La forêt mangeait petit à petit ce qui avait dû être, autrefois, une pâture à moutons.
Parvenu au sommet, il reprit son souffle, son haleine exhalant un halo de vapeur blanche. Le froid de plus en plus vif piquait ses oreilles, mais son corps était chaud, son énergie intacte. Il longeait la crête quand, dans une trouée, il aperçut la vallée et, tout au fond, son village bordant la rivière : l’église massive, le presbytère avec son jardin clos, l’école de son enfance, quelques maisons serrées tout autour. La lumière bleutée de la pleine lune permettait de distinguer le moindre petit détail. Au-dessus de lui, la voûte étoilée scintillait de mille feux. Interrompant cet instant magique, un chevreuil dérangé aboya deux fois avant de décamper.
Il reprit son chemin et, à l’orée du bois, déboucha sur une maison de vacances. Une couche de glace se formait à la surface de la piscine. Il longea les bâtiments fermés avant d’entamer la descente par la petite route goudronnée envahie de feuilles de chêne craquant sous le gel. Alors qu’il abordait le dernier virage, une boule de poils noirs se jeta sur lui en pleurant. Sa chienne, son caniche, compagnon des bons et des mauvais jours, première à l’attendre, à souffrir de son absence, qui l’avait senti depuis un bon moment, n’en pouvant plus de joie. Puis ce fut la ferme, le petit Fordson bleu dans son hangar, la terrasse, le ginkgo centenaire et, par la fenêtre de la cuisine, sa mère, nettoyant la table en cerisier. Son cœur se serra. Il était chez lui.
Étienne Gouyou-Beauchamps