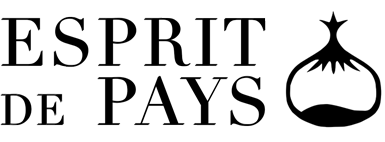Le bois de châtaignier est riche en tanins, des substances polyphénoliques. Cette particularité lui confère une résistance à la pourriture et aux piqûres d’insecte (il est également bien connu qu’il repousse les araignées !) et donc une durabilité certaine en extérieur, une quinzaine d’années pour un piquet de vigne, par exemple. C’est à la fois une qualité puisqu’on peut extraire ses tanins pour l’industrie, mais c’est aussi un inconvénient dans la mesure où le bois mouillé noircit facilement et oxyde le métal. (1)
Un peu de botanique
L’appellation botanique du châtaignier, castanea, vient du latin Castanis, lui-même dérivé du grec kastanon, une ville de Thessalie en Turquie, renommée dans l’antiquité pour la qualité des châtaignes qu’on y récoltait. Castanea était l’ancien nom des chênes avant de désigner le châtaignier (la famille des Fagacées, à laquelle appartient le châtaignier, regroupe également le chêne). Sativus signifie « cultivé » en latin.
Le châtaignier est un arbre, sauvage ou cultivé, qui peut atteindre 25 à 30 mètres de haut, exceptionnellement 30 à 40 mètres. Son port est plus ou moins étalé selon l’environnement où il se développe. Son tronc rectiligne est gros et relativement court, recouvert d’une écorce fissurée en long. Il peut facilement mesurer 4 mètres à 5 mètres de diamètre à la base, ce qui n’a rien d’exceptionnel. Le doyen des châtaigniers ardéchois à 1 000 ans, et son tronc mesure 12,5 mètres de circonférence. À Thenon-les-Bains, un exemplaire, lui aussi millénaire, a un tronc qui mesure 15 mètres de circonférence. Mais, le record est incontestablement détenu par un châtaignier qui a grandi sur les pentes de l’Etna, le plus vieux des châtaigniers connus qui a actuellement quatre troncs et qui mesure 55 mètres de circonférence (il était encore plus imposant lorsqu’il possédait ses cinq troncs). On l’a surnommé « le châtaignier des 100 chevaux », car il aurait accueilli sous son ombrage, à l’époque de la Renaissance, l’escorte d’une reine de Naples, Giovanna I d’Angio (Jeanne Ière d’Anjou, la reine Jeanne), forte de cent cavaliers, qui s’y abrita un jour d’orage.
Il s’épanouit entre 300 et 800 m d’altitude, bien qu’on le rencontre jusqu’à 1 200 m. Il ne pousse que sur des sols silicieux, acides, de pH compris entre 5 et 6, et plutôt dans des sols riches en humus, sablonneux ou argileux ; par contre, il est calcifuge, c’est-à-dire qu’il n’apprécie guère les terrains calcaires. S’il accepte les sols silico-argileux, trop d’argile entretient une humidité excessive que le châtaignier ne supporte pas. D’une façon générale, il n’aime guère les sols trop humides et trop lourds, et il accepte souvent des sols ingrats : les terres légères, sèches voire stériles, les roches et les pierrailles… bref, des terres impropres à la plupart des cultures. Dans son Traité de la Châtaigne, Augustin Parmentier (1737-1813) constate que le châtaignier « offre aux habitants de certaines contrées, comme une espèce de dédommagement à l’aridité du sol qu’ils habitent ».
Il profite plus vite dans des sols frais en hiver et au printemps, et il a besoin de lumière et de chaleur pour que la pollinisation se fasse dans d’excellentes conditions. Cet arbre à affinités méditerranéennes réagit assez bien à la sécheresse, mais il redoute le froid et l’humidité ; il craint tout particulièrement les gelées hivernales. Beaucoup de châtaigneraies ont été anéanties certains hivers rudes, notamment lors du Grand hiver de 1709 qui a marqué les esprits, car une famine s’était développée suite à cet épisode hivernal. En Périgord tout particulièrement, des forêts entières furent dévastées, les chênes se fendirent dans toute la longueur, et les châtaigneraies furent dévastées.
Sa croissance est très rapide. Il possède une forte aptitude à émettre des rejets. En à peine vingt ans, il a atteint sa taille adulte. C’est d’ailleurs en raison de sa rapidité de pousse qu’il fournira le bois de chauffage pour les hauts-fourneaux des nombreuses forges périgourdines, après transformation en chardon de bois. Il produit annuellement de 50 à 70 kilos de châtaignes sur une période d’une soixantaine d’années. Si toutes les conditions qui lui sont favorables sont réunies, sa longévité peut dépasser 1000 ans.

La pollinisation du châtaignier
Le châtaignier est un arbre monoïque, ce qui signifie qu’il possède à la fois des fleurs mâles et femelles. La fécondation croisée est une règle impérative chez le châtaignier. Il ne fleurit qu’au bout d’une vingtaine d’années. C’est en juin-juillet que des fleurs mâles de 10 à 20 centimètres apparaissent, dressés, en forme de chaînettes de couleur jaune dorée, en même temps que de petites fleurs femelles, insignifiantes, groupées par un à trois dans une cupule. Les inflorescences se développent sur les rameaux de l’année, à l’aisselle des feuilles terminales ou subterminales.
La pollinisation est liée aux conditions climatiques : elle s’effectue par les airs, on parle alors de pollinisation anémophile, ou grâce aux insectes, et dans ce cas, il s’agit d’une pollinisation antomophile. La germination du pollen nécessite des températures maximales de 27 à 28°C, ainsi qu’une hygrométrie basse ; cette dernière favorise la libération du pollen qui sera alors transporté par le vent ou les insectes. Dans les régions ou l’hygrométrie est basse (Sud-est méditerranéen et Italie), le vent disséminera de façon efficace le pollen. Dans les régions plus humides (Ouest et Sud-ouest de la France), le pollen est généralement plus visqueux, limitant l’action du vent. Se sont alors les insectes, et plus particulièrement les abeilles, qui assureront la pollinisation (les fleurs étant riches en nectar et très parfumées, elles sont particulièrement attractives pour les insectes).
La période de châtaignaison s’étale de mi-septembre à début novembre — Pour en savoir plus, consultez la page La châtaigne : un peu de botanique.
La répartition du châtaignier en Périgord
En Périgord, on relève la présence de châtaigniers dans des sites archéologiques datant de l’époque glaciaire. Aujourd’hui, le châtaignier est une des essences les plus répandues en Périgord. Ce serait même en Périgord que la châtaigneraie (La Castanhal) occuperait encore la plus grande superficie en France avec un peu plus de 15 000 hectares.
On le trouve dans le Périgord Vert ou sur les placages sablo-argileux recouvrant par endroit les plateaux calcaires du Périgord Central et du Périgord Noir. Il est traité, soit en « vergers » formant de belles mais rares châtaigneraies (La Castanhal) claires, lumineuses avec une strate herbacée importante ; soit, plus fréquemment, en taillis hétérogènes, car le châtaignier est associé traditionnellement au chêne pédonculé, au chêne tauzin et, de plus en plus, au pin maritime qui progresse dans ce domaine.
Aussi, quand le Périgourdin pouvait consacrer son activité aux céréales ou à la vigne, le châtaignier a vu son domaine se limiter. C’est ainsi que, dans le Bergeracois, les trois cantons de Montpazier, de Baumont et de Cadouin qui, seuls, possèdent un revêtement siliceux, ne comptent ensemble que 800 hectares de châtaigneraie sur une superficie totale de 35.000 hectares. C’est que, dans cette région, le sol est, en général, trop fertile pour que l’habitant s’occupe du châtaignier. Au contraire, dans le Sarladais et le Périgord Blanc, où les conditions d’existence étaient les plus dures, l’homme s’est attaché à cet arbre qui prospère sur la terre siliceuse, considérée comme la plus ingrate et où n’auraient pu être cultivées que la pomme de terre ou la vigne.
Le Périgord offrait donc de larges zones de terrains où le châtaignier pouvait prospérer. En 1936, dans la Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, Mme Depain dresse un état des lieux très détaillé, tellement précis que nous avons choisi de le reproduire in extenso :
Le département de la Dordogne est constitué de terrains qui se succèdent du Primaire au Tertiaire ou Quaternaire, à mesure qu’on va du Nord-Est au Sud- Ouest. Sa géologie procède de celle des deux régions qu’il unit : le Bassin d’Aquitaine et le Plateau Central.
Des terrains cristallins (gneiss, micaschistes, quartzites, arkoses, schistes, granites), au Nord de Nontron-Thiviers-Excideuil- Génis, prolongent les massifs anciens de la Haute-Vienne et de la Corrèze. D’autre part, des assises primaires, à l’Est de Hautefort-Châtres, se rattachent au bassin de Brive. Ces deux régions constituent, au Nord-Est du département, le Nontronnais qui appartient au Limousin par ses sols.
C’est au Sud-Ouest de cette zone que commence le véritable pays périgourdin qui nous intéresse. Le Secondaire y apparaît en succession normale : Trias, Lias, Jurassique et Crétacé. Il donne des formations presque toutes calcaires jusqu’à une ligne reliant La Roche-Chalais, Mussidan, Bergerac, Lalinde et Cadouin. C’est sur le pays à l’Est de cette limite que se sont déposés les sables sidérolithiques, au début du Tertiaire : ils couvrent encore de vastes portions du Bergeracois et du Sarladais surtout. Au début de l’Eocène, de nouvelles formations, connues sous le nom de « sables et argiles du Périgord », commencent à se déposer, notamment dans la région de Perigueux et dans la Double et le Landais qui ont alors émergé.
Sables sidérolithiques et « sables et argiles du Périgord » sont deux dépôts analogues : ils proviennent à la fois de la désagrégation des roches siliceuses du Massif Central, dont les produits ont été entraînés par le ruissellement, et de la décomposition sur place du Jurassique ou du Crétacé. Le sidérolithique, parfois remanié, a donné des grès, des terres réfractaires, des kaolins. Souvent les sables et argiles qui le constituent prennent une teinte rougeâtre par latèrisation. Les « sables et argiles du Périgord », rarement remaniés, n’ont pas été affectés par ce phénomène. Presque toujours, ces deux espèces de dépôts se rencontrent sur les hauteurs, tandis que les vallées sont taillées dans les calcaires et les rivières en ont balayé les dépôts superficiels.
La châtaigneraie périgourdine se limite aux domaines des sables sidérolithiques et des sables et argiles du Périgord qui, seuls, dans le département de la Dordogne, contiennent la silice favorable à sa croissance. Aussi, la châtaigneraie ne peut-elle être que discontinue ; et c’est sous cet aspect qu’elle se développe dans le Périgord Blanc, le Sarladais, le Bergeracois, le Ribéracois, la Double et le Landais.
Mais dans ces différentes régions, la place du châtaignier est loin d’avoir une égale importance. Justement, la plus grande ou la moindre extension des dépôts tertiaires auxquels son existence est liée conditionne son développement. C’est ainsi que l’Est du Sarladais où commence le Causse, le Sud du Bergeracois qui appartient à l’Agenais et l’Ouest du Ribéracois apparenté à l’Angoumois, ne présentent aucune trace des dépôts tertiaires du Périgord ; l’on n’y trouve pas de châtaignier.
Dans cette châtaigneraie périgourdine ainsi limitée, il faut encore distinguer des nuances. Celle-ci se présente sous deux aspects essentiels : la châtaigneraie à fruits, la châtaigneraie-taillis. La prédominance de l’une ou de l’autre provient, le plus souvent, de l’action de l’homme. En général, on rencontre un mélange intime du taillis et du verger, d’autant plus que le premier procède presque toujours du second. Il est rare de voir, comme dans la région de Villefranche-de-Périgord, le taillis devenir châtaigneraie ; par contre, couramment, la châtaigneraie se transforme en taillis.
Toutefois, dans la Double et le Landais, le châtaignier n’a jamais pu exister qu’à l’état de taillis : sur 38.000 hectares de bois environ qui s’étendent dans ces deux régions, on compte à peine 320 hectares de châtaigneraies-vergers. Et pourtant les sables et argiles du Périgord recouvrent ces deux pays presque sans solution de continuité. Mais ces dépôts ne présentent à aucun moment une épaisseur supérieure à 0 m. 30-0 m. 40. Au-dessous, au lieu des calcaires que l’on rencontre dans le reste du Périgord, s’étale une nappe d’argile imperméable. Ainsi, les racines du châtaignier se heurtent rapidement à un milieu humide dans lequel elles ne peuvent se développer. Bien plus, l’infiltration des eaux étant difficile, souvent la faible couverture argilo-sableuse, saturée d’eau, est encombrée d’étangs et de marécages. Mais si ce soubassement argileux est défavorable au châtaignier, la couverture supérieure n’en est pas moins, par nature, un milieu propre à cet arbre. Chaque fois que la pente est suffisante pour que les eaux qui filtrent à travers les sables s’écoulent plus bas sur la nappe imperméable, le châtaignier peut s’installer. La limite que l’argile sous-jacente impose à ses racines ne lui permet pas d’atteindre de grandes dimensions. Mais ces conditions sont suffisantes pour que les hauteurs de la Double et du Landais soient parfois couvertes d’un taillis de châtaigniers.
Le climat du Périgord, de type girondin, est également favorable aux châtaigniers. La température n’y est jamais excessive. Les gelées de printemps ne sont guère à redouter. Les vents dominants viennent du Sud-Ouest et de l’Ouest, amenant la pluie et réchauffant la température. Ceux du Nord-Ouest, moins fréquents et plus froids, apportent également l’humidité. Le département est donc suffisamment arrosé et les pluies sont bien réparties entre les douze mois. Ces conditions climatiques répondent aux exigences du châtaignier : la température lui est propice ; les gelées qui lui sont souvent fatales restent assez rares ; le degré d’humidité est suffisant, même dans les mois de juillet, d’août et de septembre qui coïncident à la fois avec le minimum de pluviosité et avec la période où, justement, pour former et mûrir ses fruits, il a besoin d’eau. Le châtaignier a donc trouvé en Périgord un milieu physique particulièrement favorable.

Les multiples usages du châtaignier
Le châtaignier possède des caractéristiques intéressantes. Les connaître permet de mieux comprendre pourquoi ce bois est apprécié et utilisé depuis très longtemps en Périgord comme ailleurs. Le bois de châtaignier est naturellement écologique puisqu’il n’a pas besoin d’être traité chimiquement contre les insectes. En effet, en raison de la forte présence de tanins (7 à 10 % de la matière sèche, pour l’essentiel des tanins ellagiques tels que castalagine et vescalagine), c’est un bois imputrescible résistant à la pourriture et aux parasites, comparable à certains bois exotiques. On cite parfois l’exemple du grenier à grain de l’abbaye de Cluny qui possède une charpente en châtaignier de 400 ans, intacte et toujours indemne de toiles d’araignées, pour confirmer le fait que le bois du châtaignier repousse les insectes. Il peut donc être utilisé en intérieur comme en extérieur. C’est en fait l’une des essences locales qui vieillit le mieux en extérieur, sans traitement chimique.
C’est pourquoi il servait autrefois à la tonnellerie. On dit que les tonneaux en bois de châtaignier améliorent la qualité des vins. Sa résistance exceptionnelle à l’humidité et aux moisissures, ses caractéristiques de solidité et de souplesse, font que le bois de châtaignier est toujours très apprécié en bois de mine, pour les échalas dans les vignes, les manches d’outils, en menuiserie et en ébénisterie, pour les escaliers, les poutres, les portes et les fenêtres, mais aussi pour les bois de charpente et les parquets. Enfin, de manière plus marginale, il est utilisé dans certaines régions pour la couverture de bâtiments (lauzes de châtaignier). En vannerie, les jeunes perches de trois à huit ans d’âge sont refendues et planées soigneusement pour réaliser des paniers très robustes. Après avoir indiqué les différentes utilisations du bois de châtaignier, le célèbre naturaliste français François de Paule Latapie (1739-1823), considère que « les châtaigniers sont la production la plus utile du Périgord ». (3)
C’est un assez bon bois de chauffage, mais il doit être réservé impérativement aux foyers fermés, car il crépite et lance, en éclatant, des étincelles très loin du foyer.
On a qualifié le châtaignier « d’arbre civilisation » tant il a influencé la culture des hommes en général et des Périgourdins en particulier. Car cet arbre lui a rendu de multiples services : comme on l’a vu il est, en effet, utilisé dans l’alimentation, l’industrie et le commerce. Mais ce n’est pas tout : même les feuilles et les bogues ne sont pas perdues. On les incorpore au fumier de la ferme en alternant les couches. Cela donne un engrais acide qu’on emploie pour les pommes de terre et qui d’ailleurs n’est pas d’un excellent résultat. Feuilles et bogues peuvent aussi être ajoutées aux herbes coupées sous les châtaigniers pour la litière des animaux. Quant aux feuilles sèches, recueillis au sol, elles étaient conservées pour alimenter la litière des animaux à l’étable, ou, pour les plus pauvres, constituer la « paillasse » d’un matelas.
Enfin, lorsque le bois est de mauvaise qualité (roulure) – parce que le châtaignier est devenu vieux et qu’il ne donne plus de fruits, ou lorsqu’il est frappé par la foudre ou atteint par la maladie – il peut être utilisé, après extraction du tanin, pour produire de la pâte à papier. À la fin du XIXe siècle, des usines de tanin se sont donc établies là où le châtaignier était le plus abondant en Dordogne : à Lanouaille, à Condat-le-Lardin et à Couze. Les deux dernières de ces usines ont adjoint à la production du tanin, la fabrication de la cellulose ou pâte à papier. Cette association s’explique par le fait que la cellulose est retirée des résidus des produits qui ont servi à l’extraction du tanin. Toutefois, la crise économique étant passé par là, l’extraction du tanin a cessé, mais l’usine de Condat produit toujours du papier (de marque « Périgord »), tandis que l’usine de Couze s’est spécialisé dans la production de panneaux lamifiés. — Voir notre article Polyrey, l’amour du bois.
Notes :
- (1) Le châtaignier : un arbre, un bois, Catherine Bourgeois, Éric Sevrin et Jean Lemaire, Institut pour le développement forestier, Collection Les guides du sylviculteur.
- (2) Wikipedia, Castanea sativa.
- (3) Manuscrit des Archives de la Société Historique et Archéologique du Périgord publié par Jean Maubourguet, Secrétaire-Général de cette Société, Éditions de la Société Historique et Archéologique du Périgord, 1939.
Crédit Photos :
- Fleurs de châtaignier, By Wouter Hagens (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons.
- Feuille de châtaignier, By Nadja1 (Own work), via Wikimedia Commons.
- Fleurs de châtaignier, By Naoneisig (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons.
- Fleur de châtaignier (glow plan), By Wouter Hagens (Own work), via Wikimedia Commons.