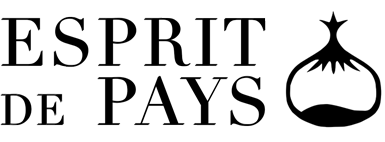Avec les Papeteries de Condat, l’usine de Rottersac constitue l’un des fleurons de l’industrie papetière en Périgord. Appartenant aujourd’hui au groupe suédois Munksjö, le site de l’usine lindoise produit du papier depuis 1815. Découvrez les grandes étapes d’une activité papetière qui se perpétue depuis deux siècles…
C’est dans un acte notarié daté de 1742 qu’apparaît pour la première fois le nom de Moulin de Raute Sac. Vers 1762, la carte de Belleyme mentionne Rotechat. Au XVIIIe siècle, au lieu-dit Rottersac (commune de Lalinde), existe donc un moulin, alimenté par la source du Souci. Nous n’avons pas de précision sur la nature de sa production. Cependant, la tradition orale évoquant l’existence d’un couvent en ce lieu au XVIIIe, le moulin en question était probablement un moulin à blé.
Ce dont nous avons la certitude, c’est qu’à l’initiative de Jean Jardel, papetier à Couze, l’activité papetière est attestée sur le site à partir de 1815. Le 27 mai 1819, une lettre du préfet de la Dordogne adressée au ministre de l’Intérieur confirme cette activité : « La quantité des ouvriers peut varier selon les besoins. Dans ce moment, 45 à 50 sont employés à la fabrication d’un papier violet pour l’emballage du sucre ». Quelques années plus tard, en 1839, l’auteur d’un carnet de voyage décrit les bâtiments de l’usine de Rottersac comme totalement abandonnés.
Présence d’une verrerie au XIXe siècle
En 1855, l’activité reprend sur le site grâce à la famille Riols de Fonclare, originaire de Moussans, dans le Haut-Minervois. Cette famille exerce le métier de verrier depuis le XVe siècle. Pierre Jean Isaac de Riols de Fonclare est le créateur de la verrerie de Rottersac. Son fils Angeli lui succède et développe l’entreprise. En outre, avec l’un de ses frères, il met au point un nouveau système de four pour lequel ils déposent un brevet. Angeli décède vers 1870, époque où les affaires de la verrerie périclitent. À l’évidence, la défaite de 1870 face à l’Allemagne a précipité le déclin de l’activité et entraîné la fermeture de la verrerie.
Georges Gaulon & Compagnie
En 1872, Georges Gaulon rachète l’usine et crée une papeterie. Il fait installer la première machine à papier en continu, ce qui nécessite de faire passer le débit de la prise d’eau sur le canal de Lalinde à 1 700 litres/seconde. L’autorisation est obtenue par décret préfectoral en 1876. Ces investissements et modifications hissent l’entreprise Georges Gaulon & Compagnie, parmi les meilleures de France.
 En 1880, le journal Le Panthéon de l’Industrie fait l’éloge du papier teinté-chiné, vélin et vergé, fabriqué à Rottersac. Les résultats sont probants, mais à la mort du fondateur, en 1906, la société connaît des difficultés financières. Elles ne sont d’ailleurs pas liées à une mauvaise gestion mais à une succession de faits occasionnés par des décisions étrangères à l’entreprise. En effet, entre 1905 et 1908, la construction sur la Dordogne du barrage de Tuilières fait monter le niveau de la rivière de 3,50 m. Cette montée subite perturbe l’alimentation de la turbine et crée une inondation dans la salle de la machine à papier. Il faut alors remonter le matériel à l’étage et remplacer les moteurs hydrauliques, ce qui nécessite un arrêt total de la production jusqu’à l’arrivée de nouveaux moteurs. Les livraisons n’étant plus assurées, il s’ensuit l’annulation des commandes et la perte de la majorité de la clientèle. Le coup de grâce survient le 3 octobre 1910. L’explosion du cylindre sécheur de la machine à papier fait s’écrouler tout espoir de reprise. Le 3 décembre 1910, la dissolution de l’entreprise est ordonnée par le tribunal de Bergerac.
En 1880, le journal Le Panthéon de l’Industrie fait l’éloge du papier teinté-chiné, vélin et vergé, fabriqué à Rottersac. Les résultats sont probants, mais à la mort du fondateur, en 1906, la société connaît des difficultés financières. Elles ne sont d’ailleurs pas liées à une mauvaise gestion mais à une succession de faits occasionnés par des décisions étrangères à l’entreprise. En effet, entre 1905 et 1908, la construction sur la Dordogne du barrage de Tuilières fait monter le niveau de la rivière de 3,50 m. Cette montée subite perturbe l’alimentation de la turbine et crée une inondation dans la salle de la machine à papier. Il faut alors remonter le matériel à l’étage et remplacer les moteurs hydrauliques, ce qui nécessite un arrêt total de la production jusqu’à l’arrivée de nouveaux moteurs. Les livraisons n’étant plus assurées, il s’ensuit l’annulation des commandes et la perte de la majorité de la clientèle. Le coup de grâce survient le 3 octobre 1910. L’explosion du cylindre sécheur de la machine à papier fait s’écrouler tout espoir de reprise. Le 3 décembre 1910, la dissolution de l’entreprise est ordonnée par le tribunal de Bergerac.
La Société Anonyme des Papeteries de Rottersac
Au début de la Première Guerre mondiale, l’usine est reprise par Léopold Schneeberger. Du fait de la guerre, le papier se vend mal. Il faut donc s’orienter rapidement vers d’autres productions. Léopold Schneeberger choisit alors de fabriquer du coton à nitrer. Sa perspicacité va sauver l’entreprise car il va fournir la Défense nationale pendant toute la durée de la guerre. En mai 1918, Léopold Schneeberger s’associe à des actionnaires afin de créer une nouvelle papeterie : la Société Anonyme des Papeteries de Rottersac dont le capital s’élève à 1 400 000 francs. Son fils Louis en assure la direction.
Les années d’après-guerre sont plutôt favorables à l’entreprise. L’activité reprend à Rottersac et tout va pour le mieux jusqu’au terrible incendie de 1924. Plusieurs bâtiments sont détruits, notamment celui du dépôt de chiffon et celui de la machinerie. Les pertes s’élèvent à 800 000 francs. Le sort s’acharne car cette tragédie en engendre une autre : le décès de Mme Schneeberger. Choquée par l’ampleur de l’incendie, elle meurt d’un arrêt cardiaque. Louis Schneeberger n’aura pas le cœur à relever ce nouveau défi. Les ateliers ferment et les ouvriers sont mis au chômage. Ils ne reprennent l’activité qu’en 1927. Un emprunt de 4 millions de francs permet à la Société Anonyme des Papeteries de Rottersac de rembourser au pair et par anticipation l’emprunt des 4 000 bons décennaux qu’elle avait émis après l’incendie. Ces bons donnaient droit, en sus d’un intérêt de 7 %, à une prime sur le chiffre d’affaires de la société. L’emprunt permet aussi aux Papeteries de Rottersac de prendre une participation importante dans la constitution de la Compagnie Fibro-Gluteor qui exploite les usines de Papeterie et Cartonnerie de Moissac.
L’usine redevient productive. La fabrication est concentrée sur la production des pâtes de chiffon, pâtes d’étoupes de lin et de chanvre, pâtes de coton blanchi, et sur des pâtes à hautes résistances destinées aux fabrications des papiers spéciaux de l’industrie électrique. S’ajoute à ces spécialités la création d’installations techniques entièrement nouvelles portant sur les procédés les plus récents de défibrage, de blanchiment, et surtout d’épuration des matières premières utilisées, ce qui fait des Papeteries de Rottersac l’usine la mieux équipée dans sa spécialité en France.
Grâce à ces nouvelles fabrications, les Papeteries de Rottersac, élargissent leur clientèle. Elles s’introduisent sur le marché anglais où elles n’avaient jamais fait affaire. L’Italie, la Belgique, l’Espagne puis les États-Unis ouvrent des perspectives financières encourageantes. En 1929, ces marchés représentent plus de 3 millions de francs. S’ajoute à ceci la production de Moissac où la société des Papeteries de Rottersac a pris des intérêts. Des licences et brevets sur la fabrication de papier carton fibres et carton valise permettent à cette unité de fournir un carton spécial aux plus importantes fabriques d’automobiles, notamment pour les intérieurs de véhicules, offrant ainsi un débouché considérable.

Tout semble aller pour le mieux. Mais une autre épreuve se prépare de l’autre côté de l’Atlantique. Entre le 24 octobre et le 29 octobre 1929, la Bourse de New York s’effondre. Outre-Atlantique, l’évènement va créer une crise sans précédent qui a pour conséquence directe le chômage et la pauvreté. Cette grande dépression se propage au reste du monde et, à partir de 1931, affecte la France. Les espoirs d’exportation s’envolent, d’autant plus qu’en 1932 la dévaluation de la livre britannique entraine dans sa chute le franc.
L’usine de Rottersac ferme en 1932. Elle laisse sur le pavé une centaine d’ouvriers. Le 20 octobre 1934, il est procédé au tribunal civil de première instance de la Seine à la vente en un seul lot de terres, bâtiments, outillage et matériel. La mise à prix est de 400 000 francs. La crise économique étant à son paroxysme, aucun acquéreur ne se prononce. Deux nouvelles mises à prix sont proposées dans les séances suivantes. Finalement, l’ensemble se monnaye à 100 000 francs. Nous n’avons pas de renseignements précis sur l’acquéreur, mais il est fort probable que ce soit Monsieur Vaunac. Nous le retrouvons propriétaire de l’usine en 1944. Comme à l’évidence il n’a pas pu acheter Rottersac pendant la période de guerre, il a probablement acquis ce bien avant 1939.
À l’image de la Première Guerre mondiale, les années noires de la Seconde sont néfastes à l’industrie du papier. Pour l’usine de Rottersac, la guerre va encore accentuer la tragédie. Le fils de Monsieur Vaunac, Jean, ingénieur de l’usine, appartient à la Résistance. Le 21 juin 1944, il commande un groupe de maquisards de Lalinde posté à Mouleydier. Après un combat inégal, les résistants sont anéantis par les Allemands. Le village est totalement brûlé. Quelques maquisards échappent au massacre. Gravement blessé, Jean Vaunac est fait prisonnier. Les Allemands le laissent agoniser sans aucun soin, attaché à un arbre toute la journée, en plein soleil. Ils l’exécutent le soir avec vingt de ses camarades. Monsieur Vaunac ne se remettra pas de la mort de son fils. Rottersac devenant une charge dont il ne veut plus assumer la responsabilité, en 1947 il engage René Sibille. Il lui cède à bail l’usine avant de la lui vendre en 1952.
L’ère René Sibille
Né en 1893 à Morestel en Isère, René Sibille est entré dans l’industrie vers 1919. Directeur de la papeterie du Guiers (Savoie), c’est au cours d’un voyage en Allemagne qu’il découvre la fabrication du papier cristal. Ne pouvant pas convaincre sa hiérarchie de créer une unité de fabrication de ce nouveau papier, il quitte son poste pour fonder sa propre société. En 1929, il achète une ancienne usine de défilage de chiffon aux Échelles (Savoie) pour y installer les machines d’une tuberie d’Aix les Bains. Sa société se nomme Turboboite. Après la Deuxième Guerre mondiale, la première Papeterie René Sibille voit le jour dans le Jura. On y fabrique le papier cristal qui fera la renommée des Papeteries Sibille.
Dès le rachat de l’usine de Rottersac, en 1952, René Sibille n’aura de cesse de rénover cette unité de fabrication. En 1957, l’usine possède deux machines. Par la suite, deux autres sont installées en vue de tripler la production. En 1966, René Sibille passe le flambeau à son fils Christian. À l’instar de son père, Christian continue à moderniser ses usines. En 1968, il fait installer la machine n° 5, un monstre de 72 mètres qui classe l’unité de Rottersac parmi les établissements les plus performants d’Europe dans la fabrication du papier cristal.
En 1973, deux cent cinquante ouvriers et trente cadres forment l’effectif, placé sous la direction de Monsieur De Libouton, apparenté à la famille Sibille par son épouse. Quelques années plus tard, Christian Sibille fusionne avec le groupe Stenay comprenant trois usines dans lesquelles six machines à papier fonctionnent, portant la capacité de production du groupe à 150 000 tonnes/an. L’effectif sur les trois sites est de 850 personnes. En 1990, une nouvelle fusion avec la société Dalle fait entrer la société finlandaise Ahlstrom comme actionnaire minoritaire. Jusqu’en 1996, Christian Sibille reste à la tête du groupe, puis il cède ses parts au groupe Ahlstrom. À l’âge de soixante-six ans, il assure ainsi la pérennité de l’entreprise créée par son père.
Le nom de Sibille reste à jamais gravé dans l’histoire industrielle de Lalinde. Partenaire pendant des années de toutes les manifestations sportives, l’usine de Rottersac a largement contribué au développement du sport à Lalinde : rugby, football, vélo, basket. Elle fut et elle reste l’un des piliers économiques du secteur.
Le groupe suédois Munksjö
En 2013, le groupe suédois Munksjo rachète Rottersac et en confie la direction à Thierry Chassagne, un enfant du pays. La papeterie emploie actuellement près de 200 personnes. Elle est en plein développement. Le site possède deux machines à papier. L’une produit environ 8 000 tonnes de papier/an, l’autre, construite sous l’ère de Christian Sibille, plus de 50 000 tonnes. La fabrication est diversifiée : emballages souples pour produits alimentaires et non alimentaires, notes repositionnables d’une marque très connue (Post’it du groupe 3M) et papier cristal pour fenêtre d’enveloppes.
Le groupe Munksjo a fait de son usine de Rottersac le centre de services de sa clientèle au niveau européen. Il vient d’investir 4 millions d’euros sur un nouveau bâtiment de stockage : 9200 m2 qui pourront accueillir 10 000 tonnes de papier. Depuis 2013, 13 millions d’euros ont été investis sur l’usine de Lalinde. Soucieux du respect des normes environnementales, l’usine s’est également dotée d’une station d’épuration physico-chimique dimensionnée pour une ville de 30 000 habitants…
Patrimoine industriel de la ville depuis deux siècles, Rottersac a connu des hauts et des bas, mais à chaque époque, des hommes se sont battus pour surmonter les épreuves.
Christian Bourrier, Photos © Pierre Boitrel, Jean-Marie Vonarb