Les tondues de la Libération
Dans 1944 en Dordogne, Jacques Lagrange voit dans « l’acharnement que certains mettent à poursuivre les belles de Périgueux, de Bergerac et de Sarlat » la preuve que « ce mouvement est essentiellement populaire. Avec ce qu’il a de spontané, de sauvage, de cruel, il n’échappe pas au cortège des faits divers accompagnant toute révolution. (11) » Or, il semble maintenant clairement établi que l’Épuration a été, réfléchie, organisée, planifiée. En dépit de quelques débordements dont on ne peut nier qu’ils sont le fait d’actions populaires spontanées, l’Épuration a, le plus souvent, été mise en place, pour ne pas dire mise en scène. C’est le cas des tontes de « collaboratrices » qui ont lieu à Bergerac sur les marches du palais de Justice. Le choix du lieu n’est pas innocent. Sous le porche d’un tribunal où justice est rendue, des femmes soupçonnées de s’être « compromises avec les Boches » sont châtiées, publiquement. Les marches les plus hautes font office de podium, et du haut de cette estrade improvisée, officient les « coiffeurs » en blouse blanche. Ils président à une cérémonie qualifiée par Alain Brossat de « carnaval moche » (12). Le rituel public de la tonte, écrit cet auteur, est « une fête, un jeu, une exhibition, une cérémonie (…) Pour souligner qu’il s’agit d’un jeu, d’un “ théâtre ”, le marquage, ébauche de déguisement, joue un rôle décisif dans la cérémonie des tontes ; le “degré zéro” du travestissement, c’est la croix gammée que l’on trace à la peinture, au goudron, que l’on “sculpte” avec des ciseaux sur le crâne, que l’on dessine sur le visage, les seins, les fesses, voire le corps entier de la tondue. »
Dans son journal personnel, Renée Guimberteau relate la Libération de Mussidan (Dordogne), le 22 août, et mentionne « l’enlèvement des collaboratrices » le jour même. « Malheureusement il pleuvait à torrent et nous n’avons pas pu les voir » écrit-elle. Le 24 août, « la promenade » des collaboratrices n’avait toujours pas eu lieu « car la foule les aurait esquintées ». Il faut attendre que les esprits échauffés s’apaisent pour que le « spectacle » puisse commencer. Le 2 septembre 1944, soit 11 jours après la Libération, elle écrit : « Ce matin on a bien ri. Les FFI ont tondu sur la place les collaboratrices (…) Il y avait un monde fou. On les a promenées dans toutes les rues puis ramenées en prison (13) ».
Ce matin on a bien ri. Les F F I ont tondu sur la place les collaboratrices…
Parfois, ces « exécutions capillaires » sont ordonnées sur décisions de petits chefs de maquis locaux. Pareille mesure touche Léonie B., Solange T., Jeanine L. et Jeanine D. (17 ans), les 12, 13 et 23 septembre 1944. Dans leurs dossiers respectifs, l’énoncé du « jugement » apparaît en toutes lettres : « À tondre ». Plus de trois mois après la libération de la Dordogne, le 6 décembre 1944, le lieutenant Jean Méthou, officier du BSM (14), ordonne la tonte publique de Rose S., couturière, « prostituée d’habitude ». La sentence est finalement exécutée à la prison de Bergerac (15).
Les tontes de la Libération n’ont pas épargné les hommes. À Bergerac, une mère et son fils font les frais de la coupe à la mode, baptisée « coupe 44 ». Dans l’édition de France Libre du 8 septembre 1944, sous le titre « Un châtiment », on peut lire : « Samedi dernier, un camion a ramené, tondus, une mèche grotesque bouffant sur le sommet du crâne, la croix gammée tatouée sur le front, la patronne de “La Civette” et son fils. Sur leur masque blême, ce n’était plus le vice triomphant qui s’étalait mais l’ignominie du châtiment. Nous n’apprendrons pas aux Bergeracois qui étaient cet homme et cette femme, ni ce qu’ils ont fait pendant la guerre. Le scandale qu’ils ont déchaîné sous l’occupation était si grand qu’il criait vengeance. Les faire marcher au pas de l’oie avec de tels stigmates, sous les huées de la foule, était un commencement de punition méritée. Quand le crime a été public, la réparation doit aussi être publique ». Le 16 mai 1945, le quotidien Les Voies Nouvelles rend compte de l’audience de la Cour de justice en ces termes : « La femme A. S., 56 ans, tenait à Bergerac le bar-tabac “ La Civette ” qui ne tarda pas à être transformé par sa propriétaire en lieu de débauche pour les officiers, sous-officiers allemands et des prostituées. Le fils de l’accusée, V. L., 30 ans, de moralité plus que douteuse, aidait sa mère dans sa vile besogne. On accuse en outre V. d’avoir un jour, en compagnie d’Allemands, distribué des tracts contre le maquis ». Dans sa séance du 26 mai, la cour de justice de Périgueux condamne à mort le fils, et à vingt ans de travaux forcés la mère, condamnation assortie d’une confiscation des biens. Le 11 février 1948, la mère réapparaît en Dordogne. Son nom figure sur une liste de détenues transférées à la prison pour femmes de Mauzac. Il est précisé dans son dossier : « …a entretenu des rapports avec des sujets ennemis, fait des actes de commerce avec l’ennemi au mépris des prohibitions édictées, accompli des actes nuisibles à la défense nationale ». La peine ayant été commuée en six ans de réclusion, sa libération intervient le 7 décembre 1950.

Groupe de tondues photographiées devant l’entrée principale du Palais de Justice à Bergerac, septembre 1944
L’internement des « collabos » à Périgueux
Au cours de l’été 1944, les conditions de détention des personnes arrêtées et détenues, en attente de jugement, soulèvent ici et là des commentaires indignés. Le 26 août, Louis Feyfant, maire de Périgueux, rencontre Maxime Roux, préfet de la Dordogne. Sur la question de l’internement des « collabos » à Périgueux, le maire dégage sa responsabilité. Il exprime sa réprobation et pose un ultimatum : soit la situation change dans les 48 heures, soit il démissionne sur le champ. Le préfet reconnaît que « dans la période insurrectionnelle présente », des cas lui ont été soumis d’exécutions sommaires et d’arrestations arbitraires. Il s’en ouvre dans une lettre adressée à la « direction FFI », composée d’une part de Roger Ranoux, alias Hercule (FTP) et d’autre part de René Boilet, alias Gisèle (AS). Roux évoque « les sévices corporels » que subiraient les prisonniers au 35e, « des simulacres d’exécutions (…) le suicide d’une détenue ». En fait de « suicide », il s’agit d’une femme qui se serait précipitée par la fenêtre d’un des étages de la caserne afin d’échapper à une tentative de viol. Pour marquer sa « volonté formelle de faire cesser de tels excès », le préfet convoque une commission et prévoit de visiter les locaux du 35e d’Artillerie. Cette visite a lieu deux jours plus tard, le lundi 28 août. La commission est composée du préfet, du maire de Périgueux, du chef d’état-major FFI, de deux délégués du Comité départemental de Libération et de deux délégués du Comité communal. Dans le compte-rendu qui suit, le préfet rapporte que « la visite a été faite avec la plus grande objectivité et n’a donné lieu à aucun incident (…) L’alimentation n’a fait l’objet d’aucune plainte… ». Ce rapport, dont on sait qu’il ne reflète pas la réalité, ne présente d’intérêt que parce qu’il dénombre précisément la population internée : 366 prisonniers, dont 147 femmes (40,16 %) et 73 prisonniers allemands.
La presse périgourdine se fait l’écho des communiqués « angéliques » de la préfecture. Le journal Les Voies Nouvelles du 2 septembre 1944 titre : « À l’ombre des cachots du 35e – Interview aux prisonniers ». En introduction il est rappelé – fort justement – que le 35e était « il y a quelques jours encore, le lieu de torture des martyrs de la France et de la liberté. Aujourd’hui, il est transformé en prison, pour les hommes et les femmes qui ont pris le parti de l’ennemi et sacrifié la patrie à des ambitions personnelles ou intéressées ». Aux prisonniers « interviewés » il est demandé s’ils sont bien traités depuis leur incarcération : « Ils répondirent tous affirmativement. Les cellules sont propres et la nourriture qui leur est accordée est suffisante. Tous ont été unanimes à le déclarer (…) Nous avons demandé à plusieurs d’entre eux s’ils avaient à se plaindre. Eux aussi furent unanimes à rendre hommage à leurs gardiens qui, comme le disait le commandant, ne font que leur devoir de Français. » Le chroniqueur des Voie Nouvelles admet qu’il a pu y avoir « des incidents » au cours desquels les prisonniers furent maltraités. Mais « le personnel de la caserne ne peut en être responsable ; car lors de leur transfert, la foule enfonça des barrages de police, pour montrer sa haine envers de tels individus (…) Si des exagérations se sont produites dans le délire de la Libération, les esprits quelque peu enfiévrés de nos compatriotes se sont apaisés et le peuple périgourdin a retrouvé toute sa dignité ».
Le « peuple périgourdin », quant à lui, ne semble pas très convaincu par ce discours. Un communiqué de la préfecture, publié dans le quotidien France libre du 8 septembre 1944, tente d’asseoir « la vérité officielle ». Les conditions d’hygiène et d’alimentation du 35e RAD sont déclarées « satisfaisantes, ainsi que j’ai pu le constater moi-même [dixit le préfet] au cours d’une visite faite en compagnie du Comité départemental de Libération, de M. le maire de Périgueux et des chefs d’état-major FFI (…) L’œuvre entreprise n’est pas une œuvre de vengeance, mais de justice ». Cette dernière phrase fait référence aux propos du secrétaire général provisoire à la Justice, l’avocat communiste Marcel Willard, qui, le 29 août 1944, s’adressant aux chefs d’établissement pénitentiaires déclarait : « Le châtiment que la Nation exige est une œuvre de Justice et de salut public, non de basse vengeance. J’entends donc que tous les détenus placés dans votre établissement soient traités convenablement et ne soient l’objet ni de sévices, ni de brimades ». En ce qui concerne la Dordogne, cette assertion relevait de la déclaration d’intention et du vœu pieux.
Alertée par des familles de prisonniers, la Croix-Rouge française fait état de « sévices corporels qui continuaient à être exercés sur les prisonniers par des groupe de soldats FFI ayant pénétré dans les locaux avec la complicité ou la passivité des soldats de garde ; absence totale d’hygiène (paille pourrie, vermine, etc.) ; insuffisance de l’alimentation. » Le 17 octobre 1944, le chef de bataillon Geronimi, commandant la subdivision militaire de Périgueux, conclut son rapport en signalant que de telles conditions sont « indignes de la justice française ». De fait, le 8 novembre, le préfet prie le directeur départemental du Ravitaillement général de bien vouloir faire livrer au 35e RAD huit tonnes de paille « pour le remplacement de celle qui est souillée », celle-ci étant « remplie de vermine, rendant insoutenable le séjour des internés à la caserne ». Le 24 novembre 1944, soit environ trois mois après la première visite d’inspection effectuée par les autorités préfectorales et municipales de Périgueux, une note signale toujours la présence de « 376 individus détenus à la Caserne du 35e d’artillerie (…) non placés sous mandat de dépôt ». La proportion de femmes n’est pas précisée.
Au début de l’année 1945, en dépit du rétablissement de la justice républicaine, les conditions de détention demeurent préoccupantes. Le 20 janvier, la maison d’arrêt de Périgueux fait l’objet d’une visite du procureur de la République, accompagné de la directrice de la Croix-Rouge. Pour une capacité de 200 hommes et 50 femmes, la population détenue est de 237 hommes et 68 femmes (28,7 %). Le procureur rapporte : « Mon attention s’est surtout portée sur le quartier des femmes, où la situation est la plus grave. Voici exposé sans vaine sensiblerie le résultat de mes constatations (…) À la faveur de cette surpopulation prospèrent, au point de menacer les gardiens et d’être répandus à l’extérieur par les visiteurs, poux, punaises, et maladies contagieuses telle que la gale, etc. (…) Un exemple : les femmes couchent à trois sur deux paillasses rapprochées, chacune ayant une place de 0,60 m. environ (…) Ajoutons que voisinent la nomade voleuse de volailles, la fille publique ou la justiciable de la cour de justice, et l’on sait qu’en Dordogne, des arrestations ont été faites pour des infractions qui ne sont parfois que des délits d’opinion », et le procureur de la république, de conclure : « On a à juste titre critiqué le régime de Vichy. Il faudrait que, sans bienveillance excessive certes, on rompe cependant formellement avec des pratiques analogues, indignes d’une nation libre et des grands principes d’humanité républicains ».
Jacky Tronel
chercheur associé au projet « Prison militaire du Cherche-Midi », à la Maison des Sciences de l’Homme, Paris. Membre du comité scientifique de la revue « Histoire pénitentiaire ». Éditeur du blog Histoire pénitentiaire et Justice militaire.
Sources et notes :
- (11) Jacques Lagrange, 1944 en Dordogne, Périgueux, Pilote 24, 1994, p. 537.
- (12) Alain Brossat, Les tondues – Un carnaval moche, Levallois-Perret, éditions Manya, 1992. Cf aussi Fabrice Virgili, La France « virile » – Des femmes tondues à la libération, Paris, Payot, 2000.
- (13) Source Émile Guet. Cf Patrice Rolli, « Les tondues à Mussidan : contexte et signification », infra.
- (14) Le Bureau de sécurité militaire (BSM) est dirigé par le commissaire de Police René Redouté, chef du service des renseignements (SR). À ne pas confondre avec le Bureau de sécurité départemental (BSD), dirigé conjointement par Pierre Vorms, alias commandant Claude et par le Yougoslave André Urbanovitch, alias Doublemètre.
- (15) Archives départementales de la Gironde, 17 W, (relevé effectué par Jean-Jacques Gillot, co-auteur avec Jacques Lagrange de L’épuration en Dordogne selon Doublemètre, Périgueux, Pilote 24 édition, 2002).
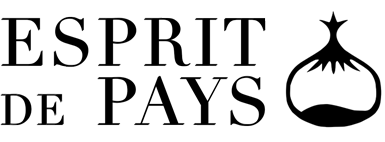











En écho à votre article, plasticienne engagée, j’ai réalisé une série intitulée « La trahison des images» sur la tonte des “filles-à-boches” à la libération en 1945. La tonte des cheveux participe de la dépersonnalisation, au lieu du châtiment et de l’humiliation.
A découvrir : https://1011-art.blogspot.com/p/le-bon-exemple.html