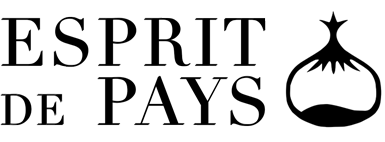Les origines du château de Lacypierre nous ont été longtemps inconnues, malgré la présence des armoiries gravées dans la pierre, mais que personne n’avait encore identifiées. Les historiens du Périgord nous dirigèrent d’abord sur une fausse piste. Il fallu attendre les travaux opiniâtres d’Annick Lebon-Hénault, aidée par des amis chercheurs, pour éclairer l’histoire de la bâtisse et des familles qui l’avaient habité.
L’intégralité de ces recherches a été publiée en septembre 2018, dans un livre intitulé « Lacypierre, la mémoire retrouvée », aux Éditions Esprit de Pays. Pour en savoir plus sur ce livre – et vous le procurer –, consultez les informations qui figurent en fin d’article. Voici l’avant-propos du livre…
Avant-propos
Lorsqu’à l’été 1968 nous sommes arrivés dans la propriété de Thonac, près de Montignac, où nous louions pour la deuxième année consécutive une chambre d’hôtes, nous étions loin de penser que nous abordions un tournant de notre vie. La vieille maison XVIIe, couverte de lauzes, ouverte à tous vents, transformée en séchoir à tabac, que l’on appelait la maison du juge, dénomination justifiée par l’épigraphie de la balance gravée au-dessus de la porte d’entrée, et sur laquelle nous avions flashé l’été précédent, avait été vendue à un maître d’œuvre corrézien.
C’était une déception, nous en avions, depuis une année, subodoré en silence et chacun pour soi, les restaurations possibles et le financement. Nos moyens étaient limités, mais nous étions jeunes, enthousiastes et téméraires, il nous fallait rebondir et élargir le cadre de notre quête. À Sarlat, un agent immobilier nous propose de consacrer une après-midi entière à la visite de maisons de caractère à réhabiliter et dont le coût correspondait à notre budget, nous sommes allés jusqu’aux confins du haut Quercy.
C’était un temps où la fascination touristique du Périgord n’avait pas atteint son paroxysme, où la recherche d’authenticité pouvait encore se satisfaire aisément, où l’on pouvait dénicher la perle rare au cœur d’un hameau ou au creux d’un vallon.
Cet après-midi-là, notre quête ne fut pas convaincante, jusqu’au moment où, sur la route du retour, passé Salignac et traversant le Poujol, sur la commune de Saint-Crépin, notre guide nous dit : « J’ai bien quelque chose, là en bas, mais ça ne vaut rien ». Il lui fut répondu : « Au point où nous en sommes, M. Trèves, allons voir ».
À l’issue du tournant de la petite route qui descend au vieux bourg de Saint-Crépin, nous est apparu, dans son écrin de chênes verts, ce quelque chose qui ne valait rien, avec ses deux tours, l’une carrée, l’autre polygonale, ses épaisses toitures de lauzes et dans le même alignement, comme en contrepoint, le clocher carré de l’église romane toute proche. La vision était saisissante de simplicité, d’équilibre et d’harmonie, elle opéra sur nous un charme, au sens classique d’envoûtement. Ceux qui ont éprouvé dans leur vie le choc d’un coup de foudre esthétique comprendront.
1. Une ruine debout
À l’approche de la demeure, la vétusté des lieux s’imposait partout, telle une culpabilité. Loin de briser notre éblouissement initial, cette misère développa en nous un sentiment de commisération et de piété, ainsi qu’une responsabilité militante : il n’était pas possible de laisser s’écrouler un pareil témoignage de l’architecture et de la société rurale du Périgord d’autrefois.
Bien qu’en très mauvais état, le bâtiment devenu exploitation agricole depuis plus d’un siècle, abritait encore les métayers de la famille qui en était propriétaire : la notable famille Malbec, originaire de la commune, mais que la vie moderne avait dispersée. Dans le partage successoral établi quelques décennies plus tôt : Joseph avait eu la maison de famille située à quelques cinq cents mètres, au village du Poujol, belle demeure de maître traditionnelle du XVIIIe siècle, tandis que son frère Étienne avait hérité de la ferme, ci-devant château.
Après avoir vendu les meilleures terres aux cultivateurs voisins, Édouard Malbec, fils d’Étienne, qui vivait entre le Bordelais et l’Angoumois, souhaitait se débarrasser, peut-être d’ailleurs à contre cœur, mais nécessité fait loi, de cette ruine debout qui, depuis bien des lustres, n’était d’aucun rapport. Le bâtiment, inséparable de son écrin de chênes verts qui constituait son environnement immédiat et son cadre protecteur, avait été inscrit à l’Inventaire des Monuments historiques en 1946 sous le nom de Château de Cipières.
La vétusté du bâti était un gage d’authenticité. Le château était meurtri, mais tel qu’en lui-même depuis la fin du XVIIIe siècle, pour n’avoir depuis lors – ou du moins depuis les années 1825 – jamais été habité bourgeoisement ou noblement. Il avait évité ainsi les fréquents apports de conforts et de prestige du XIXe siècle, facteurs de conservation certes, mais qui ont souvent dénaturé les demeures anciennes.
Une visite chez les libraires nous apprit vite que le charme du site n’avait pas échappé aux artistes et aux historiens contemplateurs du Périgord Noir. De Lucien de Maleville à Jean Maubourguet, en passant par l’œuvre monumentale de Jean Secret, les représentations graphiques et photographiques du château de Saint-Crépin s’étalaient même parfois en page de couverture des ouvrages.
Nous avons dit château, à peine cependant, à moins de se rappeler la boutade du député Foucault de Lardimalie à l’Assemblée en 1790 s’adressant à Bailly : « dans la province de Périgord, il suffit qu’une maison ait une girouette pour qu’on lui donne le nom de château ». La girouette était bien là, sommant la toiture de lauzes de la tour polygonale portant l’escalier en vis.
2. Des origines mystérieuses
La terminologie utilisée était variable, pour les uns, c’était un château, pour d’autres, un manoir, voire même la maison des Cipières, les termes de repaire ou de maison forte étaient plus rarement utilisés. L’avenir nous prouvera que, lors de sa vente aux Malbec en 1846 par les descendants de ses antiques possesseurs, il sera sobrement parlé d’une maison de maître. Quant à l’orthographe du nom, elle était plus incertaine encore : La Cipière, Lacipière, Lacypierre, Cipier, Sipière… un choix aussi vaste que flou, que nourrissait l’ignorance de ses origines.
Si nous devions en croire l’étymologie proposée par Marie-Thérèse Morlet, Cipière viendrait du latin cipparius, dérivé de cippus désignant une borne ou un pieu enfoncé dans le sol pour délimiter un champ ou un territoire, suivit du suffixe aria. Le dictionnaire occitan d’Yves Lavalade évoquait la cepa, c’est-à-dire une touffe végétale ou un rejet de souche, tout en précisant qu’un texte occitan limousin daté de 1240 présente le nom propre de cipiera. Nous avions donc là un patronyme très ancien.
L’expérience a souvent prouvé que la mémoire, par la seule transmission orale, n’excède guère la deuxième génération. On se souvient de ce que les parents et les grands-parents nous ont conté, mais il est bien rare de pouvoir aller au-delà sans failles et surtout sans déformations, à l’exception de ces légendes tenaces que la mémoire familiale ou villageoise engrange et enjolive, qui animaient les veillées d’énoisage, mais dont la fiabilité laisse souvent à désirer. Ainsi celle de l’éternel souterrain (recelant peut-être un trésor), dont tout le monde parle, dont personne ne connaît les issues, mais dont chacun vous affirme qu’il a connu quelqu’un qui l’avait emprunté, même qu’il a failli y rester enfermé. Hélas, il n’est plus de ce monde pour en parler lui-même !
L’origine du nom restait mystérieuse, la mémoire de tous étant bien défaillante. En revanche, il nous était abondamment parlé des messieurs Malbec, les derniers propriétaires, avec le plus grand respect. De bien honnêtes gens, toujours généreux pour la commune et dont le paternalisme de bon aloi s’exerçait encore au travers de leurs descendants. Édouard Malbec, notre vendeur, abritait dans le château devenu ferme, ses vieux métayers Léonie Lascombes et son mari, en toute gratuité. Il est vrai que l’habitat était fruste, sans aucun confort et qu’ils avaient travaillé la terre ingrate de cette petite exploitation à la force de leur courage et fort probablement pour un revenu de misère depuis quarante ans. Pour remercier le maître, ils étaient convenus d’engraisser deux cochons, un pour eux, l’autre pour lui, vestige des baux à mi-fruits et mi-croît qui ont perduré si longtemps dans notre Périgord. Édouard nous a confié, non sans humour, que Léonie lui annonçait souvent que l’un des deux cochons était mort : « Je ne demandais jamais lequel ! ».
3. Quête d’identité
Nous étions persuadés que pour apprivoiser l’âme d’une demeure qui avait vécu longtemps avant nous et dans laquelle nous n’avions personnellement aucun souvenir de famille, il nous fallait en rechercher l’histoire et, en priorité, l’existence de ceux dont elle portait le nom. Qui étaient ces Lacypierre dont personne, dans le village n’avait entendu parler et qui ne figuraient même pas dans les origines de propriété de l’acte notarié ?
Un premier indice vint de l’église paroissiale toute proche, ouverte en permanence à toutes les tentations. Dans la désolation d’une sacristie à l’abandon, au fond du tabernacle d’un autel désenchanté, nous avons découvert un calice d’argent de dimension moyenne dont le piédouche, ciselé de perles dans le plus pur style Louis XVI, portait l’inscription suivante : « Offert par Monsieur, Madame et Mademoiselle de Lacypierre ». Brusquement, ce patronyme sortait de l’oubli.
Très ultérieurement, nous avons pu constater que l’objet figurait bel et bien dans l’inventaire dressé en 1905 lors de la loi de séparation des Églises et de l’État, comme étant un don de M. de Lacypierre, décédé.
Pour ne blesser personne, nous n’évoquerons pas la démarche que nous avons entreprise, sans résultats, tant auprès du maire de l’époque que du curé, pour leur demander de fermer à clef la porte de l’église. Le calice fut volé par des mains sacrilèges quelques semaines après notre découverte, en même temps que d’autres objets de culte (chasubles, ciboire) ainsi que les statuettes du retable XVIIIe ; en un temps, pas si lointain, où les municipalités faisaient peu de cas de leur patrimoine culturel.
Dans les bibliothèques consultées, les ouvrages de Jean Secret, historien et président de la très savante Société Historique et Archéologique du Périgord, évoquaient l’existence d’une famille Delpy de Lacipière qui aurait (au conditionnel), donné son nom au château de Saint-Crépin. Nous avons cru devoir suivre cette piste. Certes, les documents ne manquaient pas, car cette famille était assez bien connue dans le Sarladais. L’un de ses dignes représentants avait été maire de Sarlat sous l’Empire (de 1802 à 1812). Si sa filiation s’était éteinte dans les mâles, plusieurs de ses descendants, par les femmes, étaient encore présents dans la région de Sarlat. On les trouvait à Salignac, au château de Toulgou, au château de La Lauvie, sur la commune de Simeyrols, mais jamais à Saint-Crépin. Leurs armoiries ne correspondaient en rien à celles gravées, tant au-dessus de la porte de la tour que sur le linteau de la cheminée en pierre de la salle et que le précieux Armorial du Périgord d’Alfred Froidefond de Boulazac avait omis de répertorier. Notre recherche s’annonçait hasardeuse.
Dans l’ouvrage intitulé Les Enfants Célèbres du Canton de Salignac, le Dr Paul Villatte, l’historien du Salignacois, consacrait un chapitre au repaire du Toulgou et aux Delpy de Lacipière qui en avaient été, au temps de la Révolution de 1789, les propriétaires et presque les reclus. Paul Villatte, a-t-il repris à son compte l’hypothèse de Jean Secret, selon laquelle « le château de Saint-Crépin (propriété de Monsieur Étienne Malbec) appartenait à la famille Delpy de Lacipière », ou est-ce au contraire Jean Secret qui s’en est inspiré ? Nous l’ignorons. Quoiqu’il en soit, ces deux honorables historiens ont, sans le vouloir, mais en raison même de leur notoriété, largement contribué à la diffusion d’une contre-vérité, reprise à l’unisson, depuis soixante ans, par tous les folliculaires et commentateurs d’histoire locale.
Cependant, en se référant à un acte trouvé dans les papiers du notaire Constant (actuellement aux archives de Tulle), Paul Villatte, en toute fin de chapitre, soulevait un coin du voile qui allait nous conduire à la vérité : « Il existait, disait-il, en 1777, une famille Bénié de Lacypierre, aussi ancienne, sinon plus ancienne que la famille Delpy de Lacipière et dont l’origine salignacoise devait être commune, sans qu’il soit possible d’en faire la preuve ». Et si c’était elle qui avait donné son nom au château ?
Un nouveau champ d’investigation s’ouvrait devant nous ; il fut long car nous ne l’avons pas emprunté immédiatement, un peu par négligence, et surtout parce que nous étions absorbés par l’urgence des travaux de restauration que l’état de la bâtisse nous imposait.
Il n’entre pas dans les limites de cet ouvrage d’évoquer toutes les techniques employées pour la réhabilitation archéologique de la demeure, ceci est affaire de spécialiste. Nous limiterons cet essai à une modeste tentative de rétablissement de la vérité historique entourant ceux et celles qui en avaient été les bâtisseurs ou les possesseurs dans les siècles passés.
Entre la lointaine famille de Ferrières, chevaliers en Salignac, qui détenaient des droits féodaux sur le bourg et divers manses dans la paroisse de Saint-Crépin au Moyen Âge et les Malbec qui achetèrent une partie du domaine en 1845 pour le faire exploiter par des métayers et loger ces derniers dans la maison de maître, il fallait, et c’était toute justice, s’intéresser à la famille éponyme qui, dès la fin de la guerre de Cent Ans avait relevé le fief, exploité les terres, embelli et habité la demeure et conservé l’ensemble intact durant quatre siècles, en dépit des aléas de l’Histoire : les Benié de Lacypierre.
Les sources utilisées, souvent lacunaires, proviennent, pour l’essentiel, de différents fonds d’archives publics : Archives départementales de la Dordogne, de la Corrèze, du Lot, de la Gironde, Archives nationales, Archives militaires de Vincennes, Archives de Versailles, Archives municipales de Sarlat et de Saint-Crépin, mais aussi de fonds privés de familles qui ont eu la générosité et la grande gentillesse de nous les confier.
Chacun peut constater, aujourd’hui, un retour en force de la généalogie. Il était nécessaire d’établir celle des Bénié de Lacypierre afin de structurer toutes les recherches, mais cette approche était insuffisante pour apporter un témoignage vivant. Il nous a paru indispensable de situer les diverses branches de cette famille dans leur environnement local, culturel, social et naturellement familial et professionnel et d’évoquer les événements historiques de première grandeur qui ont bousculé leurs parcours. Au fur et à mesure que nous déroulions le fil de ces vies, un foisonnement de découvertes s’offrait à notre curiosité.
Depuis toujours, les historiens s’intéressent à la noblesse de cour, la plus riche, la plus influente, celle qui, à travers ses vertus et ses vices, ses grandeurs et ses ridicules, ses modes et ses préjugés, a donné le ton à toute une civilisation, bien au-delà de nos frontières. La petite noblesse désargentée, celle des hobereaux de province, commence seulement, depuis peu, à susciter quelque intérêt. Les contours de la société d’Ancien Régime n’étaient pas aussi immuables et figés que certains le laissent entendre. Bien avant la Révolution, la société d’Ordres avait déjà volé en éclats, l’approche de la famille Bénié de Lacypierre va nous en donner la preuve.
Bourgeois par leurs origines, sans avoir jamais été marchands ; issus de la magistrature provinciale, sans espoir d’anoblissement (les charges au Présidial n’étaient pas anoblissantes et leur importance ne cessa de décliner au cours du flashflashXVIIIe siècle) ; privilégiés parce que seigneurs fonciers ayant acquis des droits féodaux sur des terres nobles, sans l’être eux-mêmes, mais vivant noblement ; ils recherchaient, dans les carrières militaires, l’accomplissement de leur place dans la société et l’accession à la noblesse héréditaire qu’ils n’obtiendront que tardivement. La Révolution brisera les ailes de leur ascension sociale.
Avec le dernier descendant mâle des Bénié de Lacypierre, prénommé Guillaume Antoine Hugues, nous avons parcouru avec ravissement un siècle charnière d’Histoire de France particulièrement riche et tumultueux, fait de lumières et de drames. Par sa longévité (1734-1826), par son indéfectible attachement à la monarchie, par le contraste de ses origines provinciales et de ses fonctions militaires qui l’ont amené à fréquenter la cour de Versailles et les plus nobles personnages du Royaume, par les malheurs de sa famille et son émigration pendant la Révolution, notre gentilhomme périgourdin s’est révélé superbement attachant. Nous consacrerons à sa mémoire une bonne partie de cet ouvrage.
Annick Lebon-Hénault

L’Histoire du Château de Lacypierre en bref…
Le château se situe à à Saint-Crépin-et-Carlucet (24590), à une dizaine de kilomètres au nord de Sarlat-la-Canédat dans le Périgord noir. C’est une gentilhommière construite de part et d’autre d’une tour hexagonale abritant l’escalier, présente également une tour carrée abritant un pigeonnier ainsi qu’un toit de lauzes. Le corps central est percé de fenêtres à meneaux.
Au Moyen Âge une première construction fortifiée a été élevée. L’existence d’un fief noble est attestée dès le XIIIe siècle comme ayant appartenu à la famille de Ferrière, de noblesse de chevalerie, hommagers du Haut et Puissant Seigneur de Salignac. La structure basse de la demeure date de cette époque. On attribue à Guilhem de Ferrières la construction du repaire avant la fin de la guerre de Cent Ans. Il semble bien que les ravages de la guerre de Cents ans aient entraîné la démolition d’une partie du bâtiment et notamment de la tour escalier. L’édifice a été reconstruit suivant un plan de manoir rural barlong avec une tour escalier polygonale. Un des angles est renforcé par une tour carrée qui ressemble plus à un pigeonnier qu’à une tour de défense et a servi de tour de justice (1).
Vers les années 1460, le fief étant vacant (la branche des Ferrières de Salignac ayant disparu), il est cédé féodalement à une très ancienne famille de bourgeoisie de robe, originaire de Salignac, les Benié de Lacypierre. L’origine de leur fortune remontait au XIIIe siècle, grâce au népotisme des Papes d’Avignon (notamment Jean XXII, originaire de Cahors), auprès desquels ils avaient obtenu des postes dans la magistrature royale depuis le XVIe siècle et d’officiers dans les armées du roi. La famille de Ferrières étaient des chevaliers vassaux des barons de Salignac. Le château est agrandi au XVIIe siècle. Il est orné d’un cadran solaire et on construit des fenêtres à meneaux. En 1605, le maçon du village y reconstruit une cheminée (1).
Le dernier à porter le nom de Lacypierre est Guillaume, né en 1734. Il ne reprend pas la charge de son père (mort subitement) et rentre à 19 ans dans la troisième compagnie des gardes du corps du roi (compagnie de Beauvau), grâce à l’appui de son oncle qui y était déjà. Il y fait toute sa carrière, reçoit, sur ordre de Louis XVI, la croix de Saint Louis en 1784 des mains de Philippe de Noailles, Duc de Mouchy et gouverneur de Guyenne, dont il était l’aide de camp. La même année, il épouse à Paris une jeune fille originaire du Dauphiné, Rose Marie Romain Borel. Ils eurent quatre enfants ( deux garçons, deux filles) tous nés à Sarlat, mais hélas les deux petits garçons meurent prématurément, les filles seules assurent la descendance et le nom va se perdre (2).
La Révolution de 1789 va bousculer la vie de cette famille. Fidèle à ses engagements et profondément royaliste, Guillaume quitte la France en 1791 pour rejoindre l’armée du Prince de Condé, laissant en Périgord sa femme, ses filles et ses sœurs, lesquels vont vivre toutes les affres des persécutions de la Terreur. La maison de Sarlat est vendu aux enchères, ainsi que les meubles et les vêtements de Guillaume. Le château de Lacypierre est saisi, vidé de son mobilier, mais ne sera pas vendu grâce à l’acharnement héroïque des deux sœurs de Guillaume. C’est une belle histoire, qui témoigne de l’efficacité des femmes, même les plus réservées, qui développent des trésors de courage dès qu’il s’agit de sauver leur famille et leurs biens. C’est seulement en 1802 que Guillaume, rentré en France quelques mois plus tôt, pourra bénéficier de la loi d’amnistie accordée par le Premier Consul aux émigrés. Il pourra reprendre possession du Château sauvé par ses sœurs. Il ne décédera qu’en 1826, à l’âge de 92 ans, un exploit pour l’époque, après avoir parcouru presque un siècle d’histoire de France et pas des moindres. Sa fille aînée Philippine hérite du château et le garde jusqu’à sa mort en 1843. Ses enfants le vendront en 1845 à un notaire nommé Malbec, qui l’achète, non pour l’habiter, mais pour mettre les terres en valeur. Des métayers sont logés dans le château qui alors va commencer à se dégrader. C’est un descendant de ce Malbec qui vend le château en 1968, à Serge et Annick Lebon qui entreprennent de le restaurer (2).
Les Benié de Lacypierre ont donc possédé ce fief pendant quatre siècles. Puisqu’ils ont reconstruit et agrandi le domaine, il est tout naturel que le château porte encore leur nom. Ce sont leurs armes qui sont gravées dans la pierre, elles se lisent « d’azur (bleu) à trois besans d’or (2 et 1), un croissant d’argent en abîme ( au centre). » Le château fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 5 octobre 1946 (2).
- Contact : annick.lebon24@orange.fr – Tél. +33 5 53 29 39 28 / +33 7 61 17 64 26 – Site internet : www.chateau-lacypierre-perigord.fr.
« Lacypierre, la mémoire retrouvée »
« Lacypierre, la mémoire retrouvée » ; publié aux Éditions Esprit de Pays, vous pouvez l’obtenir en nous contactant par mail à cette adresse : contact@espritdepays.com.
Fiche technique de l’ouvrage
- Format : 16 x 24 cm. Nombre de pages : 600. Impression : quadrichromie. Reliure : carré collé.
- Thème : Ce récit n’est pas seulement la monographie d’une famille du Périgord dont la demeure, l’histoire et jusqu’au nom étaient tombés dans le plus profond oubli, c’est l’analyse minutieuse et particulièrement bien documentée de l’organisation juridique, financière et politique de la société provinciale et rurale de l’Ancienne France.
- Contenu : Le personnage central est Guillaume Benié de Lacypierre, né au début du règne de Louis XV, son exceptionnelle longévité lui permit de connaître le sacre de Charles X. Bien qu’étant Issu d’une famille de magistrats au Présidial de Sarlat, il ne peut reprendre la charge de son père, mort prématurément, et fait toute sa carrière dans la Maison Militaire du Roi, partageant son temps entre Versailles et sa province. Homme d’Ancien Régime, possesseur de fief, privilégié, mais n’ayant pu accéder à la noblesse héréditaire que très tardivement, il est contraint, par fidélité à son Roi de basculer dès 1791 dans le camp des « hors-la-loi », ces émigrés que les nouveaux maîtres du Pays vouent aux gémonies. Cet ouvrage est aussi l’occasion d’évoquer celles qui sont les premières victimes des mesures que la Convention Nationale multiplie à l’encontre des proscrits : les mères, sœurs et femmes d’émigrés, remarquables de résilience et de courage, capables de tous les sacrifices pour sauver leurs familles de la ruine. Rigoureux dans l’évocation de cette société charnière bousculée par l’Histoire, le récit devient émouvant quand il s’intéresse à ces femmes d’émigrés, restées dans une patrie qu’elles ne reconnaissent plus, qui les suspecte de tous les crimes et tente même de les affamer. Une fresque historique, humaine et sensible, à l’encontre des clichés et des sentiers battus.
- ISBN : 978-2-9560026-7-3. Parution : septembre 2018. Prix public de vente TTC : 24 €.
Pour le commander, contactez-nous par e-mail à cette adresse : contact@espritdepays.com
Vous pouvez également télécharger notre Bon de Commande, l’imprimer, le remplir et nous le retourner…

Notes :
- (1) Page Wikipedia consacrée au Château de Cipières.
- (2) Site officielle du Château Lacypierre, « Un bijou dans son écrin », Sarlat – Périgord Noir, www.chateau-lacypierre-perigord.fr.
Crédit Photos :
- Photo de couverture : © JF Tronel.
- Fig. 1 – Le château de Lacypierre a connu un siècle de métayage, entre 1860 et 1968, date de sa vente par Édouard Malbec à ses actuels propriétaires. La bergère, au premier plan, n’est autre que Marguerite, l’une des filles des époux Lascombes, alors métayers. – Photographie prise vers 1936, date de l’électrification de la commune. La console saillant de la tour carrée témoigne de l’arrivée de la « fée électricité ». Coll. part.
- Fig. 2 – Une vue partielle du château dans un luxuriant désordre, prise dans les années 1950. On remarque les vestiges d’un cadran solaire sur la façade, et l’enduit de chaux au sommet de la tour hexagonale correspondant à la « pièce du trésor », un réduit généralement établi dans un espace particulièrement minéral, à l’abri du feu, où les seigneurs conservaient leurs archives, avec les actes féodaux et les « livres terriers » de leur seigneurie. Extrait de Châteaux en Périgord, éd. Delmas, coll. Serge Tard.
- Photos couleur : © JF Tronel.