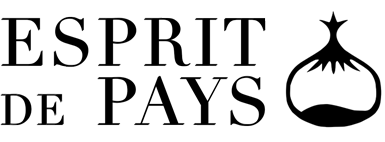Le pont métallique qui permettait aux trains à vapeur de franchir le Dropt à Eymet fête cette année ses 135 ans. L’ouvrage a pourtant conservé toute sa finesse, et il porte le poids des ans avec une rare élégance, tout en revendiquant son identité technique — ce qui ne justifie pas pour autant l’appellation « pont Eiffel » dont on l’affuble volontiers.
600 ans en 200 mètres
À 200 mètres de ce pont ferroviaire, en amont, se trouve un autre ouvrage, radicalement différent et construit en période romane, soit au bas mot 600 ans plus tôt ! On ne manquera pas de relever que, sur une distance aussi faible, il est encore possible de nos jours d’admirer deux modes de construction que tout oppose !
À ma gauche, un bâti en pierre : deux arches, en plein cintre mais différentes, deux avant-becs, un triangulaire et un carré (ils protègent les piles et offrent un refuge aux piétons), un étroit tablier pentu et des garde-corps couronnés de belles pierres.
À ma droite, la preuve que la métallurgie de la fin du XIXe siècle a produit des œuvres remarquables. Parmi les techniques innovantes utilisées ici, la poutre-treillis : le pont d’Eymet en compte deux, décalées d’une dizaine de mètres au droit des culées, l’ouvrage n’étant pas perpendiculaire à la rivière. Leurs mensurations : 70 cm de largeur, 50 m de longueur et 5,10 m de hauteur – 3,10 m en superstructure + 2 m entre le tablier et les culées.
Les fers plats ou en U et les cornières qui composent ces poutres sont tous liés par rivetage à chaud. Il s’agit du premier procédé généralisé d’assemblage en construction métallique, qui a ensuite cédé la place à la soudure, mais qui reste encore employé aujourd’hui pour la réhabilitation d’ouvrages anciens. Avant sa pose, le rivet, gros clou à une tête, est chauffé au rouge « cerise clair », soit environ 950°. Pendant l’acte de fixation, cette tête est maintenue en place par une contre-bouterolle, tandis que le fût du rivet est forgé par martelage à l’aide d’une bouterolle afin de créer la seconde tête. Lors du refroidissement, la contraction du rivet provoque le serrage des pièces entre elles. Cette excellente technique n’avait qu’un seul défaut : une mise en œuvre très lourde, ce qui a permis à la soudure de s’imposer.
Entre les poutres, un tablier de 9,50 m de largeur supportait les rails des deux voies. Il est composé de membrures reliées elles aussi par rivetage à chaud aux poutres-treillis – 2 m plus bas, celles-ci reposent sur les deux culées soigneusement bâties en pierre. En sous-face du tablier sont fixées de curieuses suspentes : on y accrochait les agrès et plateformes utilisés lors des interventions sur les structures.
Contrairement à des ouvrages plus importants, il semble que le pont d’Eymet ait été entièrement façonné sur place : taille des pièces et rivetage, lancement et mise en place des poutres et du tablier grâce à des échafaudages et rondins de bois.






À qui doit-on ce pont ?
En cette fin de XIXe siècle, sur les bâtiments et ouvrages d’art dignes d’intérêt, l’architecte ou l’ingénieur apposait une plaque, signant ainsi son œuvre. Un geste courant à l’époque.
Sur chacune des poutres du pont d’Eymet se trouve une plaque : « Société anonyme – Les Ateliers de Construction du Nord de la France • Blanc-Misseron (Nord) • 1885. » Voilà qui ressemble fort à une « plaque-signature », n’est-ce-pas ? Et pourtant, nous n’avons pas trouvé la preuve formelle que Blanc-Misseron était bien le constructeur de l’ouvrage.
Faute de certitude, nous avons élaboré une hypothèse qui s’appuie sur deux éléments sérieux. Le premier, c’est bien sûr la présence de ces deux plaques : en effet, on ne signe pas une œuvre qui ne vous appartient pas !
Second élément, on sait que Blanc-Misseron était une grande entreprise spécialisée dans la construction de matériels ferroviaires, notamment les locomotives à vapeur – dont l’assemblage des pièces se faisait (tiens, tiens !) par rivetage à chaud. Il est donc plausible que Blanc-Misseron, qui maîtrisait parfaitement cette technique, ait construit ce pont en même temps que les machines qui devaient l’emprunter.
Des lignes à tout va !
La Société du P.O. (Paris-Orléans), les Compagnies des Chemins de Fer du Midi ou des Charentes-Vendée ont tour à tour mis la main à la poche, jonglant entre leurs zones d’influence et les souhaits de l’État pour faire construire les infrastructures nécessaires à l’ouverture de lignes selon un programme chargé :
- 1873 > Bordeaux–La Sauve.
- 1886 > Bergerac–Falgueyrat–Eymet–La Sauvetat-du-Dropt-Marmande. Cette ligne ouvre un an après la construction du pont d’Eymet. Puis elle rejoint Mussidan en 1888, Ribérac en 1890 et Angoulême en 1894.
- 1889 > La Sauve–La Sauvetat-du-Dropt. Eymet se trouve alors connectée à Bordeaux et développe son attractivité.
- 1925 > Falgueyrat–Villeneuve-sur-Lot.
Tuée par un réseau routier qui ne cessait de s’améliorer, la ligne Marmande–Eymet–Bergerac est la dernière de la région à fermer, en 1953. Du coup, le pont ferroviaire d’Eymet n’avait plus lieu d’être mais, fort heureusement, il a été conservé et tient désormais sa place parmi les éléments patrimoniaux de la cité. Ne lui manquent qu’une bonne couche de peinture et un éclairage adéquat pour l’accompagner dans une nouvelle tranche de vie.
Gérard Lallemant