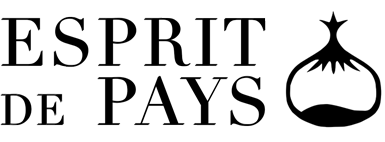…de Monpazier au Bugue en passant par Belvès et Limeuil
Dans le précédent numéro de Secrets de Pays (n° 17), nous avions laissé l’auteur du Moulin du Frau, de l’Ennemi de la mort et de Jacquou le Croquant à Monpazier. Nous allons, cette fois, accompagner Eugène Le Roy et son fils Yvon, de Monpazier au Bugue… Le récit provient de son « Carnet de notes d’une excursion de quinze jours en Périgord », publié chez Joucla, à Périgueux, en 1901.
« Nous sommes partis le soir pour Belvès. Vers neuf heures, nous arrivons à la station, où il n’y a ni voiture, ni omnibus, ni aucun moyen de transport. On nous indique le chemin qui monte à la ville. C’est, je pense, le plus roide raidillon que j’aie vu en Périgord où il y en a tant. L’ancien chemin qui montait de Domme-Vieille à la porte Del Bosc n’en approchait pas. Yvon me siffle l’air de : la goutte à boire là-haut, et je grimpe en soufflant dur, me parforçant comme un vieux cheval courageux. Enfin voici des maisons, je me crois arrivé ; point du tout ce ne sont que des écarts ; il faut se hisser encore, pour arriver au sommet du haut plateau où se trouve le véritable Belvès.
Après nous être rafraîchis dans un café, nous allons nous promener par la ville endormie. Il fait un beau clair de lune, et, dans les rues désertes, les toits et les pignons projettent leurs ombres bizarres. Parfois, à notre approche, un chat rôdeur traverse la rue et disparaît dans un soupirail de cave. Au loin, on entend le pas pressé d’un joueur de manille attardé qui regagne le logis conjugal.
Nous allons nous coucher aussi et le matin nous visitons la ville qui a bon air. Quoique vieille et irrégulière, elle est bien bâtie et propre. Elle se développe sur les hauteurs d’une âpre colline capricieusement découpée. Une vieille construction attenant à la mairie est surmontée d’une sorte de beffroi à pans coupés, très original. La vieille église est à l’extrême cime de la colline, très isolée, sauf un couvent auquel attient un vaste enclos. Dans la ville, sur la place de la Halle, un vieil édifice est accolé à un clocher primitif, sorte de toiture soutenue par quatre piliers d’angles portés par une tour carrée. Est-ce là l’ancien monastère des Templiers ? Je ne saurais le dire, n’étant, je l’avoue, rien moins qu’un archéologue. Dans la rue voisine, on remarque d’anciennes maisons avec des croisées à meneaux curieusement travaillées ; l’une de ces maisons a une belle porte, dont les sculptures et les moulures sont rongées par le temps. Ailleurs restes de tours et vieux pans de murs.
Le séjour de Belvès ne doit pas être désagréable. Des hauteurs où la ville est située, on domine la campagne environnante, bosselée de coteaux boisés séparés par des vallons peu étendus. Seulement il n’est pas aisé d’y aborder ; il y a bien une route carrossable, mais elle est très longue. Je me suis laissé conter que les hôteliers s’étaient entendus pour n’avoir pas d’omnibus, et qu’à cause de la difficulté de l’accès, pas mal de voyageurs brûlaient la ville. Je ne sais ce qui en est, mais je doute qu’on y grimpe deux fois pour son seul plaisir.
Belvès, ancienne seigneurie des archevêques de Bordeaux, a soutenu plusieurs sièges. En 1442, Jean de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord, l’enleva aux Anglais, ces antiques ennemis de la France.
Après avoir déjeuné, nous prenons le train pour le Buisson, d’où j’espère gagner Cadouin. Déception ; le courrier ne part qu’à quatre heures du soir ; il faudrait perdre toute la journée du lendemain ; nous renonçons à Cadouin. En attendant le train du Bugue, je mets mes notes à jour et puis nous promenons notre déconvenue le long d’interminables tas de bois de châtaignier qui, là comme dans toutes les stations, encombrent les abords des lignes. Bientôt les châtaigneraies du Périgord ne seront plus qu’un souvenir.
Enfin nous partons et, vers cinq heures, nous traversons une partie de la coquette petite ville du Bugue. L’omnibus nous dépose à l’Hôtel de France, d’où l’on a une superbe vue sur la rivière et sur la plaine. Le pont est là, à quelque pas et je vais m’y promener. La brume du soir commence à flotter en rasant l’herbe des prés. Pas la moindre brise. A l’occident, le soleil descend lentement derrière les collines du Cingle aux pentes dénudées, en tamisant une lumière dorée dans laquelle se dressent les peupliers immobiles. La teinte d’or du couchant se reflète dans les eaux tranquilles, où les arbres de la rive semblent prendre un bain de lumière. A gauche, au fond de la vallée, les hautes collines boisées s’obscurcissent, et tout en haut, sur une cime, pointe, éclairé par un dernier rayon de soleil, le clocher d’Audrix, l’ancien archiprêtré transféré à Montignac au dix-septième siècle. Puis le crépuscule s’étend, la nuit tombe et la lune monte lentement dans le ciel pur, comme un énorme louis d’or pâle à l’effigie usé par le frai.

Ding ! Ding ! Ding ! C’est la cloche du dîner. L’homme ne vit pas seulement de poésie, mais encore, à l’occasion, de toutes sortes de bonnes choses. D’ailleurs, il y a aussi de la poésie dans un bon dîner bien servi. Celui-ci était excellent, plantureux, et arrosé de bon vin de Périgord. Il y avait notamment une soupe maigre aux légumes, qui, à elle seule, valait le voyage du Bugue. Bref, j’ai retrouvé là, avec plaisir, cette bonne vieille cuisine périgordine, relevée, savoureuse, succulente, qu’on ne connaît plus à Périgueux, ni à quelques exceptions près, comme celles que j’ai citées, guère dans le département. Il y en a peut-être qui diront que je suis payé pour faire de la réclame aux maîtres d’hôtel ; mais comme disait le vieux briscard, je suis du régiment de Champagne et je m’en f……
Le lendemain à sept heures, nous partons pour Limeuil par le courrier de St-Alvère. Dans la mauvaise voiture découverte, il y a un entassement de paquets hétéroclites, et de journaux de toutes nuances qui vont porter la pâture politique aux bonnes gens des campagnes et fournir des arguments aux politiciens des Cafés du Centre, du Nord et autres points cardinaux. Derrière la guimbarde on a attaché une immense panière qui a dû servir à mettre des champignons, très abondants en ce moment dans les bois. À cette heure matinale, le soleil n’a pas entièrement dissipé les brumes qui flottent dans la vallée. L’air est frais, la Vézère fume et à certains endroits, bruit sur les galets des maigres. Nous suivons la route du Cingle qui côtoie la rivière à une certaine hauteur, assez pour permettre d’admirer de l’autre côté de l’eau la belle plaine avec ses prairies bordées de peupliers, ses terres cultivées, ses vignes et ses maisons éparses. Au loin, des collines dénudées ou semées par places de chênes rabougris, ferment l’horizon. Çà et là, le long de la route, des noyers, des bouquets d’arbres rompent la monotonie des terres grises d’où monte, par instant, le ha ! ha ! du laboureur faisant les semailles d’automne.
Après avoir passé en vue de la belle habitation de Peschière, un chien accourt au bruit des grelots et aboie interrogativement en regardant le courrier. Celui-ci lui jette La Petite Gironde ; l’intelligente bête la ramasse et, au galop, l’emporte à son maître, dont la maison se voit à une petite distance. Tous les matins il vient comme ça chercher le journal, nous dit l’homme.
À neuf heures, nous sommes à Limeuil, ancienne châtellenie, formée au quatorzième siècle, d’un démembrement de celle de Montignac. Un pont de construction récente traverse la Vézère, juste au confluent, et un autre en équerre au bout de celui-là, franchit la Dordogne. Tous les deux sont très étroits, deux charrettes ne s’y croiseraient pas : intelligente économie. Du pont de la Dordogne, on a une belle vue de Limeuil qui est situé à l’extrémité et sur le flanc d’une colline escarpée. Les maisons s’étagent pittoresquement en escaladant les pentes, séparées quelquefois par des rochers, des terrasses et des jardins. Quelques vieux pans de murs revêtus de lierre, soutiennent d’anciennes habitations, et, en bas, une porte de la vieille ville fortifiée débouche sur la grève, au pied de la colline où se réunissent les deux rivières.
En attendant le déjeuner commandé à l’Ancre de Salut, nous descendons la rive gauche de la Dordogne en suivant le chemin de halage. Quelle charmante promenade ! Sur l’autre rive, des coteaux arides et abrupts, où paissent des moutons qui semblent dégringoler dans la rivière. Deux troupeaux d’oies descendues des métairies voisines, évoluent sur les eaux claires, comme deux flottes qui s’observent. Puis les falaises à pic se rompent en une immense brèche où tout au fond du ravin, se trouve caché dans la verdure, le moulin de Sors. Un clair ruisseau, le Pradel, fait tourner ses meules et porte ensuite ses eaux à un autre petit moulin très vieux, tout en hauteur, d’un aspect étrange avec ses murs latéraux bâtis à angle aigu pour rompre le courant, et qui reflète dans la Dordogne ses épaisses murailles de pierre de taille, roussies par le soleil de plusieurs siècles.

Dans ce ravin enfoui sous la verdure, au bord de ce ruisselet qui tombe dans la belle Dordogne, aux eaux bleues, je ferais volontiers mon Moulin du Frau… Je le dis à Yvon.
Un peu en aval du moulin, des rochers curieusement rongés par les gelées forment des sortes de larges cannelures horizontales, arrondies, d’un effet singulier. A un endroit, ces corrosions se combinent avec d’autres, perpendiculaires, de manière à former des sortes de colonnes semblables à des piles de gigantesques fromages de Cantal. Après avoir pris une vue de ces rochers, nous remontons vers Limeuil. Chemin faisant, nous apercevons, sur la berge, un lièvre qui se promène tranquillement. Dérangé probablement dans son gîte, par des moutons qui paissent dans les environs, par prudence, il va, vient, repasse sur ses voies, les embrouille, puis remonte vers les terres, manœuvre encore, et, toujours sans se presser, disparaît dans un pli de terrain.
Nous voici à l’Ancre de Salut, près la porte de la ville qui donne sur la grève. C’est une ancienne auberge de mariniers qui doit avoir perdu sa clientèle d’autrefois, car il n’y a plus de bateaux de transport sur la rivière. Jusqu’ici je n’ai vu qu’une gabare au port de Couze, qui déchargeait, je crois, des ballots de chiffons pour les papeteries. Les auberges de bateliers sur les fleuves, disparaissent comme les auberges de rouliers sur les grandes routes. A proximité de deux rivières, on doit manger du poisson. Aussi nous sert-on une carpe frite et une belle brême. Avec cela, une omelette aux herbes, des oranges au verjus et un quartier d’oie ; le tout arrosé d’un bon petit vin nouveau du pays.
Après déjeuner, nous passons sous la vieille porte à laquelle aboutit une rue étroite, qui grimpe tortueusement au sommet de la colline. Cette rue est bordée de maisons, basses pour la plupart, et de construction ancienne. Parfois, une venelle se détache de la rue et va aboutir à une maison située au-dessus, sur quelque rocher, à un jardin accessible par des escaliers, ou à la porte d’une petite cour. En haut de la rue est une ancienne porte de la ville. Une fontaine coule près de là. Tout au faîte de la colline, est la ville haute, représentée par des maisons éparses, une sorte de place plantée d’arbres et une église sans caractère, avec son Saint-Antoine-de-Padoue, comme partout. – Quand je vous le dis !
Sur le plateau étroit qui domine la ville basse, une grande habitation est construite, dont les jardins vont jusqu’à la pointe de la colline où est une petite tour, ancien moulin à vent, ou pigeonnier, qui se voit d’en bas. Là était l’ancien château, et il en reste le puits qu’on m’a dit avoir trois mètres de diamètre. De ce point, on a la plus splendide vue du Périgord. Les deux vallées bordées de hautes collines chauves, ou boisées, ou cultivées à mi-côte, se développent harmonieusement en des cirques immenses. Leurs crêtes et leurs profils s’atténuant progressivement dans l’éloignement, finissent par se noyer et se confondre avec l’horizon lointain où flotte une légère vapeur violette. Des maisons isolées et des villages s’égrènent au flanc des coteaux plus rapprochés ; des ruines dominent des promontoires rocheux ; des châteaux campés à la cime des puys couronnent les hauteurs voisines. Sur les coteaux ou dans les vallées, au loin, un clocher aigu pointant au-dessus des maisons d’un petit bourg, monte dans le ciel bleu. Sur les pentes rapides des Cingles à l’aspect désolé, s’accrochent çà et là quelques chênes rabougris, ou de rares genévriers à la verdure terne. Des escarpements taillés en murailles géantes, se réfléchissent dans les eaux, tandis que des rochers, perçant la mince couche de terre, montrent l’ossature des coteaux, ou les surmontent de masses calcaires aux formes bizarres. Dans la plaine, des terres cultivées, des vignes, des luzernes, des labours, des prairies, découpés en parcelles régulières, semblent une gigantesque carte d’échantillons de nouveautés. Des habitations dispersées, des métairies, des cabanons, sous un bouquet d’arbres ou à l’ombre de noyers, laissent entrevoir leurs murailles blanches et les toitures rouges des granges. Le soleil fouille cet immense paysage, accuse les ravins aux flancs des coteaux, obombre les mouvements de terrain, fait briller les toits d’ardoise des châteaux, précise les arêtes des pignons et allonge l’ombre des grands peupliers, sur les prés verts, d’où monte parfois, comme un écho affaibli, les meuglements d’une vache au pâturage. Tout à l’extrême fond des vallées, la Dordogne aux eaux bleues, et la Vézère aux eaux vertes, décrivant des courbes majestueuses, sortent des profondeurs de l’horizon incertain, comme de monstrueux serpents dont les écailles brillent au soleil, et viennent en bas de la colline, sous nos pieds, marier leurs flots devant l’antique Limolh, la forteresse gauloise.
Il ferait bon avoir là, sur ces hauteurs, loin de la foule, une petite maison où se reposer des fatigues de la vie et oublier, en contemplant ce spectacle enchanteur, nos vaines agitations et les tristesses contemporaines… Mais bah ! en avant ! comme disait Nicole, nous avons l’éternité pour nous reposer. Toutes nos misères, d’ailleurs, ne sont rien au prix de celles du passé, et nous ne les trouvons si pénibles, que parce que le bien-être et la sécurité, nous ont rendus, – au moral comme au physique, – douillets et geignards. Je reste là longtemps, sondant avec la jumelle tous les détails de ce merveilleux paysage, puis nous redescendons.

Avant de repartir nous nous arrêtons un moment sur le pont de la Dordogne. Des bœufs entrent dans la rivière pour s’abreuver. Après avoir bu, ils relèvent la tête et regardent de côté tandis que l’eau tombe par filets de leur mufle puissant. Un peu en amont est amarré un mauvais bateau de pêcheurs ; et, en face, sur l’autre rive, des lavandières battent bruyamment leur linge. Au-dessus comme fond, les maisons étagées de la petite ville. On dirait un vieux tableau d’un maître classique. Au loin le grondement sourd du train sur la ligne de Bergerac…
Et nous remontons le chemin de halage de la Vézère pour revenir au Bugue, distant de six kilomètres. Jolie promenade coupée par une sieste à l’ombre d’un frêne. »
Illustrations José Correa
Auteur de Découvrir le Périgord sur les traces d’Eugène Le Roy
Éditions Cairn, 2018