Dans un mémoire adressé en 1785 au contrôleur général des Finances, M. de Bertin, les chanoines de Périgueux rappellent que le Périgord avait mérité, avant le XIIIe siècle, « le glorieux surnom de verger des Rois de France » et ils constatent qu’il est « converti en landes et en bruyères ». Pendant les siècles qui suivirent, l’agriculture périgordine n’a pas évolué, en fait elle aurait même régressée, et ce, malgré les efforts et l’exemple de certains administrateurs et pionniers, tels Tourny et Mademoiselle de Bertin au XVIIIe siècle, Bugeaud et le marquis André de Fayolle au XIXe siècle.
Lorsqu’en 1815, après son licenciement de l’armée, le colonel Bugeaud rentre chez lui, dans la région d’Excideuil, il se désole à la vue des landes semées de maigres bruyères, des immenses terrains sans végétation, des ceps étendant avec peine leurs rameaux rabougris, des prairies marécageuses, des châtaigneraies clairsemées… Quelques années auparavant, dans sa Topographie Agricole du Département de la Dordogne, André de Fayolle constate qu’en 1800, la situation de l’agriculture périgordine traditionnelle est pire qu’à la fin du règne de Louis XV. La situation est telle que les « trois-cinquièmes du département sont couverts de landes et de mauvais bois épars, et, dans les cantons où la bruyère ne peut croître, ces mêmes terres sont incultes et privées de toute espèce de végétation ». La seule innovation qu’il constate est la généralisation de la culture de la pomme de terre. Mais il ajoute que cette amélioration ne compense pas la destruction des forêts occasionnée par des propriétaires ignorants, sans parler du « zèle maladroit de Lakanal » (1). Qu’elles sont les causes d’une situation aussi misérable ?
L’agriculture périgordine en 1800, un triste constat
Il y a peu de contrées en France où l’ancienne agriculture soit plus imparfaite, les méthodes des cultivateurs moins intelligentes, les instruments du travail moins perfectionnés, l’instruction et la civilisation industrielles moins avancées. Parmi les causes permettant d’expliquer la mauvaise santé de l’agriculture périgordine traditionnelle, André de Fayolle pointe du doigt le morcellement des terres qui est, selon lui, un des plus grands obstacles à la prospérité de l’agriculture dans ce département : « Presque tous les chefs de famille ont une petite propriété (…) mais cette propriété est trop petite pour leur assurer une vie décente ; encore doivent-ils s’essouffler à aller de parcelle en parcelle, car rien n’a été fait pour l’indispensable remembrement du sol. » La condition de ces petites gens aurait été meilleure s’ils avaient travaillé dans des entreprises agricoles suffisamment vastes, dirigées par des propriétaires actifs, ne craignant pas les expériences nouvelles (1)(2).
À cela s’ajoute l’hétérogénéité des sols, les incertitudes du climat et la hantise de la faim qui font que les Périgordins pratiquent principalement une polyculture de subsistance. Seul le surplus des principales récoltes est commercialisé, en dépit de la précarité des transports qui contribue, en grande partie, à l’enclavement du Périgord (3). André de Fayolle déplore le mauvais état de la voirie qui n’était pas fameux sous l’Ancien Régime et qui a empiré après la Révolution faute d’entretien. Il ajoute également que les rivières ne sont plus navigables que sur de trop courtes sections, autant de problèmes qui interdisent tout commerce de quelque importance.
Autre problème majeur : la routine, ennemie des innovations, qui règne en maître. Les paysans sont attachés à leurs habitudes, et ils n’envisagent pas l’idée de remettre en question le savoir-faire transmis par leurs parents. André de Fayolle explique :
Les paysans ont de médiocres semences, ils cultivent mal, suivant les mauvaises méthodes, avec de déplorables outils. Les mêmes cultures, les céréales surtout, sont chaque année imposées aux mêmes terres ; s’il s’agit d’un sol de peu de valeur, on l’abandonne dès que le rendement devient par trop dérisoire et l’on défriche un coin de lande pour le remplacer ; dans les régions plus fertiles, la terre ne connaît aucun repos avant l’épuisement totale. (…) Si, encore, l’emploi des engrais était judicieusement étendu ! Mais le fumier, qui est à peu près le seul engrais connu, est d’une qualité inférieure et presque toujours insuffisant en quantité. Car, pour réserver la plus grande place possible aux céréales, surtout à la suite de l’édit sur la libre circulation des grains, les cultivateurs ont réduit les prairies au minimum ; celles qui subsistent sont, pour la plupart, ou médiocres ou sans valeur. Il y a donc peu de bétail ; un pauvre bétail, d’ailleurs, mal nourri, mal soigné et souvent abâtardi… (1)
La mentalité des périgordins pointée du doigt
En règle générale, les textes sont assez sévères avec les paysans Périgordins de l’Ancien Régime. Pour preuve, cette remarque du géographe Nicolas Desmarest : « …tant que le périgourdin vivra avec les cochons et trouvera sa nourriture au pied d’un châtaignier, il n’étendra pas ses vues au-delà de sa paroisse (4) ». Le mémorialiste Fournier-Verneuil, qui vécut à Brantôme avant 1789, décrivait avec amertume la misère et la désolation générale : « Les habitants sont presque aussi tristes que le sol ingrat qui les vit naître… le pays n’est pas beau, la nature y est âpre, rabougrie et l’habitant de cette contrée ne fait rien pour la corriger, les légumes, les fruits arrivent sans soins… point d’espaliers, point de vergers. (2) »
Ces remarques sont unanimes pour désigner les paysans comme principaux responsables de la triste condition de l’agriculture périgordine traditionnelle. Mais comment pourrait-il en être autrement ?
La condition des personnes est aussi lamentable que celle des terres. Les paysans sont ici d’un naturel “lent et paresseux”, et sans doute est-ce là à la fois un effet et une cause de leur triste situation. Les ouvriers agricoles – dans leur nombre, il faut compter ceux qui, ne possédant pas assez de terre, louent leurs bras l’hiver – sont extrêmement mal payés. Les colons, qui ne se gênent pourtant pas pour frauder dans les partages, – à peine le propriétaire réussit-il à récupérer le tiers du revenu – n’ont aucun avantage à gérer leur métairie en bons pères de famille ; car, n’étant garantis par aucun contrat, ils ne sont point assurés de n’être pas expulsés en fin d’année. Mal logés, encore plus mal nourris, ils vivent au jour le jour, le plus souvent criblés de dettes. Quant aux propriétaires qui ont consenti les beaux, ils savent aussi bien que personnes les inconvénients du métayage ; mais comment y renonceraient-ils, comment se lieraient-ils par un contrat, alors qu’il est à peu près impossible de trouver un colon qui, brisant avec les vieilles routines, sache exploiter intelligemment un fonds de terre, ou qui, le sachant, le désire ? Parfois, cependant, dans l’impossibilité de surveiller personnellement des terres trop éloignées, le propriétaire les loue pour six ou neuf ans à quelques entrepreneurs de fermes qui, à son tour, les baille à des métayers : il n’y a pas de plus sûr moyen de ruiner un domaine. (1)
Comme le souligne André de Fayolle, si la plupart des ouvriers agricoles n’ont guère le cœur à l’ouvrage, c’est avant tout parce qu’ils ne sont pas propriétaires de leurs biens. L’ignorance aidant, ils se contentent, jusqu’à la fin du XIXe siècle, de « faire un peu de tout, beaucoup de rien » pour subvenir aux besoins de leurs familles. Précisons que l’ignorance est, le plus souvent, voulue par les grands propriétaires qui tiennent ainsi les paysans soigneusement à l’écart des nouveautés, principalement pour maintenir les bas salaires. Dans ces conditions, pouvaient-ils modifier leurs mentalités et moderniser leurs modes de culture ? Ils n’en avaient ni la connaissance, ni les moyens (2).
Il y a tout de même quelques régions périgordines privilégiées, comme la vallée de l’Isle à partir de Mussidan. C’est ce que note François de la Rochefoucaud, en 1783 ; il compare d’ailleurs cette région à la Flandre (5). Pour François de Paule Latapie, la zone la plus riche est la vallée de la Dronne, entre Bourdeille et Ribérac. Les plaines du Bergeracois comptent les terres les plus fécondes, ce qui lui permet d’échapper peu ou prou à la misère, le climat doux aidant, ainsi que la proximité du marché bordelais.
Les remèdes préconisés par André de Fayolle
Dans la conclusion de son étude, Topographie Agricole du Département de la Dordogne, André de Fayolle expose les remèdes qu’il convient d’appliquer :
Il faut d’abord multiplier les prairies artificielles ; à cette seule condition on aura du bétail – un bétail sélectionné – et donc des engrais pour les terres. Sur ces terres ainsi bonifiées s’imposera un assolement plus judicieux. Il faut reboiser, surtout dans la Double et le Landais. Mais rien de tout cela ne sera obtenu si l’on ne met fin au déplorable système du métayage, si l’on n’entreprend résolument la construction de routes et l’aménagement des voies navigables. (1)
Ce n’est qu’à partir de la Restauration (1814-1830) et de la monarchie de Juillet (1830-1848) que le progrès technique et économique commencera à se diffuser dans le département de la Dordogne, bien que trop lentement. En agriculture, quelques pionniers ouvriront çà et là la voie en créant quelques fermes modèles. Mais c’est surtout grâce à une société d’agriculture active que les améliorations techniques se répandront peu à peu.
REMARQUE — Dans cet article, on a choisi d’utiliser le mot « Périgordin » plutôt que « Périgourdin ». Pour en savoir plus, consultez l’article Dordogne ou Périgord ? Périgourdin ou Périgordin ?
Notes :
- (1)Manuscrit des Archives de la Société Historique et Archéologique du Périgord publié par Jean Maubourguet, Secrétaire-Général de cette Société, Éditions de la Société Historique et Archéologique du Périgord, 1939.
- (2) Léon Michel, Le Périgord, le Pays et les Hommes, Éditions Pierre Fanlac, Périgueux, 1969.
- (3) La vie quotidienne en Périgord au temps de Jacquou le Croquant, Gérard Fayolle, Éditions Hachette Littératures, 2002.
- (4) Desmarets – Académie des Sciences – 1788.
- (5) Passant le 2 avril 1783 à Mussidan, François de la Rochefoucaud écrit sur son carnet de route : « Toute la campagne est charmante. Le long de cette route, toujours des haies, toujours des maisons, et d’une propreté qui annonce l’aisance, et que je n’ai pu comparer à la Flandre ». – Voyages en France, 1781-1783, ouvrage publié pour la Société d’Histoire de France par Jean Marchand, II, Paris, Champion, 1938.
- (6) François de Paule Latapie note à propos de la vallée de la Dronne, entre Bourdeille et Ribérac : « Tout ce qu’on y cultive y réussit… ; c’est la Touraine du Périgord ». – Archives historiques de la Gironde, XXXVIII ,458.
Crédit Photos :
- Charles-François Daubigny – Harvest – Google Art Project, via Wikimedia Commons.
REMARQUE : Si un extrait du présent article posait problème à son auteur, nous lui demandons de nous contacter et cet article sera modifé dans les plus brefs délais.
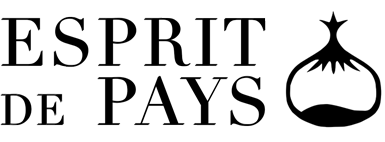











Je fais une recherche sur le château de la Fleunie à Condat sur Vezere et surtout sa ferme modèle voulue par la famille Daubrée au moment où elle en était propriétaire. Merci de me communiquer les informations s’il en existe. Et merci pour ce blog. Cordialement. Anick Chevalier
Bonjour. Veuillez m’excuser pour cette réponse tardive. Et merci pour l’intérêt porté à ce site internet. Malheureusement, je n’ai pas de renseignements complémentaires à vous proposer. Bien cordialement. JF Tronel
Merci cependant de votre reponse
Je continue mes recherches
Bonne journée AnickR